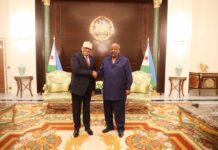Depuis 1977, la condition féminine a connu une évolution positive notable, marquée par une amélioration de la mobilité sociale des femmes, un accès accru à l’éducation et au marché du travail, leur permettant de connaître des améliorations significatives de leur statut social et économique. Les réformes ont mis en place des structures pour la promotion du genre, et des femmes ont accédé à des postes d’officiers, d’ambassadrices, de médecins et de ministres, tout en voyant leur rôle économique s’accroître.

Autrefois, la femme, debout aux aurores, était confinée à l’espace privé : à l’entretien de la maison, à l’éducation morale et religieuse de ses enfants et à la maternité, tandis que les hommes évoluaient dans l’espace public et occupaient les sphères de décision. Les Nations Unies ont officialisé la Journée internationale de la femme le 8 mars 1977, année de l’indépendance de la République de Djibouti, à une époque où les femmes djiboutiennes étaient reléguées au rang de faire-valoir, cantonnées à des rôles marginaux. Le parcours scolaire des jeunes filles s’arrêtait alors au niveau moyen, souvent limité à l’apprentissage de petits métiers, comme la couture, à l’école Notre-Dame de Boulaos. La poursuite d’études supérieures ne leur était guère envisagée.
Selon les récentes statistiques issues du recensement démographique de 2024, le pays a accompli des progrès considérables dans l’amélioration de l’accès des femmes à l’éducation, aux soins de santé et aux opportunités d’emploi. L’égalité salariale entre hommes et femmes à Djibouti est déjà une réalité. Les femmes djiboutiennes participent de plus en plus à la vie active et assument des rôles de premier plan dans la politique et les affaires, explique Djama Yabeh, spécialiste des statistiques à l’INSTAD.

Équité et égalité des genres
Première porte-parole influente dans la sphère publique et gouvernementale, la Première Dame a contribué de manière déterminante à l’évolution de la condition féminine, afin que la femme puisse conjuguer vie personnelle et vie professionnelle. En février 2025, lors du 25ᵉ anniversaire de l’Association des femmes de Tadjourah, elle a affirmé que la République de Djibouti est un pays émergent, sans discrimination, où les hommes et les femmes ont les mêmes chances de participer à son développement et de bénéficier de sa croissance.
À Djibouti, les femmes représentent plus de 52 % de la population et contribuent activement au développement économique et social du pays. Le pays a ratifié en 1979 la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Protocole de la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples relatif aux droits des femmes, la Convention relative aux droits de l’Enfant, ainsi que la Résolution 1325 des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.
Pour favoriser l’égalité hommes-femmes, la République de Djibouti s’est résolument engagée depuis 2005 dans l’élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité (SNEG), qui s’appuie sur le Politique national genre (PNG) de 2021. Celle-ci vise à instaurer un environnement favorable à l’égalité et à intégrer la dimension genre dans le développement.
Élaborée de manière participative et adoptée en Conseil des ministres, cette stratégie traduit le principe d’égalité consacré aux femmes par la Constitution.
En définitive, la pente témoigne d’un véritable redressement : les femmes sont aujourd’hui présentes dans toutes les sphères et bénéficient d’avancées majeures, portées par un engagement politique fort en faveur de l’égalité des genres. Elles investissent tous les domaines de la vie active — politique, sociale, économique — et représentent plus de 45 % du secteur de la justice.
La Stratégie nationale pour l’équité et l’égalité de la condition féminine a permis à Djibouti de se doter d’un cadre global de référence clarifiant la vision du pays en matière de genre.
Saleh Ibrahim Rayaleh