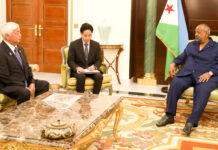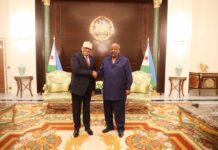Suite à la proclamation de son indépendance, la République de Djibouti s’est lancée dans un processus d’adhésion à l’organisation de la ligue arabe afin de partager un destin et une culture commune avec le monde arabe. Il s’agissait également de consolider son crédit international, car Djibouti est un carrefour commercial entre trois continents par sa position géostratégique à l’entrée de la Mer Rouge. En effet l’article 2 du pacte de la ligue arabe stipule que l’organisation doit favoriser une coopération étroite entre les membres dans le domaine de la culture. Dans ce contexte et 47 ans après son adhésion à l’organisation quelle place accorder aujourd’hui à la langue arabe sur le plan culturel, institutionnel et diplomatique ?
Il est à cet égard pertinent de la rappeler que l’arabe est la seule langue à Djibouti qui bénéficie du double statut de langue officielle et celui de langue nationale. En effet l’arabe est la langue maternelle pour un nombre important de djiboutiens ce qui lui attribue le statut de langue locale. Le caractère officiel de la langue arabe au même titre que le français, est consacré dans l’article 1er de la Constitution.
Dès son arrivée à la tête du pays le président Ismail Omar Guelleh a donné sa première interview à la chaîne Al JAZIRA en langue arabe montrant ainsi sa parfaite maitrise de la langue arabe. (Polyglotte)
Il faut également noter que le président de la république a créé le quotidien arabophone Alqran en 1997 avant même son arrivée au pouvoir. Aussi son excellence, Président Ismail Omar Guelleh a mis en place pour la première fois de l’histoire de Djibouti, une bourse d’étude spécialement destinée aux étudiants bacheliers arabophones qui souhaitent poursuivre leurs formations universitaires à l’étranger notamment dans les pays arabes.
Au cours de son premier mandat le président annonce l’ouverture d’ambassades dans six pays arabes en mettant à la tête de la diplomatie djiboutienne un ministre qui maitrise la langue arabe et manie plusieurs autres langues.
Neuf de nos vingt-deux ambassades djiboutiennes au monde se trouvent dans le monde arabe ainsi que deux de nos trois consulats.
Les principaux voyages officiels des responsables politiques djiboutiens se font dans les pays arabes.
Rien que l’année 2023, le président de la République s’est rendu dans 6 pays arabes. En Arabie saoudite le président a effectué des voyages officiels à trois reprises.2 fois au Qatar, deux fois aux Émirats arabes unies, deux fois en somalie, une fois en Égypte et une fois en Algérie. La majorité des déplacements du président de la République et les hauts fonctionnaires s’effectue dans le monde arabe, ce qui nous montre l’orientation de la diplomatie djiboutienne.
D’ailleurs beaucoup de départements djiboutiens envoient leurs employés vers les pays arabes pour acquérir de nouvelles compétences et renforcer la capacité des cadres dans l’administration djiboutienne. C’est notamment le cas des employés de la Radiotélévision de Djibouti qui font leurs stages de perfectionnement en Égypte.
Les 22 pays arabes sont invités à participer à des réunions du groupe des ambassadeurs arabes dans les différents continents (Amérique, Afrique, Asie ou Europe). L’arabe est la langue des discussions et les comptes rendus se font en arabe, d’où la nécessité pour les Djiboutiens de maîtriser les deux langues officielles du pays.
En matière de diplomatie multilatérale, Djibouti fait toujours partie du groupe arabe et du groupe africain permettant ainsi à notre pays une présence active dans les instances Onusiennes. En ce qui concerne le fonctionnement de certaines organisations internationales en l’occurrence l’OMS « les États Membres sont regroupés en six régions. Djibouti est dans le comité de la région méditerranéenne orientale. Le Bureau de la région Méditerranée orientale se trouve en Égypte. L’OMS organise Beaucoup d’événements concernant de ladite région en Égypte et Djibouti y participe. En 1973, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté l’arabe comme sixième langue officielle de l’Organisation. Cette décision confère à la langue Arabe une dimension internationale.
Quant aux organisations régionales, Djibouti participe à tous les évènements organisés par l’Union Africaine, la ligue des États Arabes et de l’IGAD.
« L’article 11 du protocole sur les amendements à l’acte constitutif de l’Union africaine dispose que les langues officielles de l’Union et de toutes ses institutions sont : l’arabe, l’anglais, le français, le portugais, l’espagnol et le swahili. »
Quant à la ligue arabe et ses instances (le Conseil de la ligue arabe, l’organisation arabe du travail, l’Union postale arabe, l’Union des télécommunications arabes, le parlement arabe et l’agence arabe de l’énergie atomique …) l’arabe reste laseule langue officielle. On remarquera que la Ligue est l’unique organisation régionale dans le monde où tous les États membres parlent une même langue. D’autres évènements diplomatiques tel que les sommets arabo-européen, arabo-chine, arabo-Afrique, arabo-américain l’arabe est aussi une des langues de discussion.
Djibouti reste incontestablement hautement stratégique pour le monde arabe. Sa position géographique lui confère particulièrement un rôle important quant à la sécurité de la région notamment la mer Rouge. Conscient de l’importance que revêt sa position géographique Djibouti a su tirer profit en se tournant vers le monde arabe. Bien avant son indépendance, le TFAI est invité à prendre part à la conférence de Taïz en Yémen en mars 1977, quelques mois avant l’indépendance de Djibouti.
Djibouti visait double objectif qui lui semblait important ; consolider sa souveraineté et développer ses échanges diplomatiques, économiques et culturels avec les pays arabes.
Les étapes de l’adhésion de Djibouti à la ligue des États arabes
La diplomatie arabe de Djibouti se définira par son adhésion à la ligue des États arabes et tous les instances interarabes.
Le 26 mai 1977 le président Hassan Gouled émet un communiqué en indiquant que Djibouti effectue une demande d’adhésion à La ligue des états arabes. Dès la proclamation de l’indépendance, le 27 juin 1977, le journal jordanien Al-Akhbar publia un entretien avec Président Gouled, qui déclarait que le peuple djiboutien est 100% arabe, tout en confirmant dans cette interview que l’arabe deviendra la langue officielle de la république à côté de la langue française.
En août 1977 le président Gouled entama sa première tournée dans les pays arabes afin de prouver l’ardeur et la volonté de Djibouti de devenir un membre de la ligue arabe.
Le 4 septembre1977, Djibouti devient le 21éme pays membre de la Ligue arabe.
Pour le monde arabe Djibouti est un allié naturel sur plusieurs plans. Il y a évidemment la proximité géographique avec plusieurs pays de la Ligue, riverains de la mer Rouge. Enfin les liens historico-culturels sont déterminants dans le processus d’adhésion. Ainsi que s’est désignée la diplomatie culturelle, économique et politique de la république de Djibouti. À partir de son intégration dans le cercle du monde arabe, Djibouti adopte des mesures « d’arabisation en signant de multiples d’accord bilatéraux. Le président Hassan Gouled rencontra le roi Khaled en août 1977 lors d’une tournée dans les pays arabes. Beaucoup de sujets ont été évoqués notamment les aides financières qui seraient allouer à la jeune république.
En novembre 1977, le ministre saoudien des Finances Mr Mansur ibrahimTurki accompagnée d’une importante délégation se rendit à Djibouti afin d’étudier les projets portés par le président Gouled.
Le Royaume de l’Arabie saoudite fut donc le premier pays à accorder à la république de Djibouti dès son indépendance une aide financière.
La signature de plusieurs accords avec l’Arabie saoudite dès 1978, une année après son indépendance a permis pour la nouvelle république de financer un certain nombre de projets. Le volume de cette aide et assistance s’élevait de 95 millions de dollars américains. Selon Mr Dalkan, premier ambassadeur de l’Arabie Saoudite à Djibouti, dans son interview donnée au fond de Madina en 1981, évoquait la répartition de l’aide saoudienne en ces termes ;
-10 millions de dollars ont été débloqués pour faire face aux charges des urgences après l’indépendance.
-5 millions de dollars pour contribuer à couvrir le déficit budgétaire de l’État de l’année 1978
– 5 millions de dollars pour compenser l’augmentation des prix du pétrole survenu en janvier 1980.
– 5 millions de dollars d’aide et d’équipement pour les forces armées et de sécurité djiboutiens.
-2 millions de dollars d’aide aux personnes touchées par la sécheresse, et 800 000 dollars de secours d’urgence aux personnes touchées par les inondations de 1980.
-55 millions de dollars pour financer la mise en œuvre de plusieurs projets dans les domaines de l’éducation, de l’arabisation, de la santé, de l’agriculture, de l’industrie, des forages de puits, des communications et médias, ainsi que dans les domaines sociaux tels que les logements sociaux, l’hébergement des enfants déplacés et des orphelins, ainsi que l’ameublement et la restauration des mosquées, l’aménagement du port, l’édification d’un hôtel de 200 chambres, construction d’une route reliant Djibouti à Tadjourah et d’une usine d’embouteillage dans la ville de Tadjourah.
L’Arabie saoudite est ainsi devenue le premier bailleur de fonds de la république naissante, tout en assumant sa promesse de prendre la relève après le départ de la France. Les autres pays de la Ligue Arabe ne sont pas en reste ainsi en août 1977 l’Irak accorda un prêt de cinq millions dollars pour le jeune État naissant.
En janvier 1980 Djibouti a également signé un accord bilatéral avec l’Irak. Ce dernier s’engagea à contribuer au développement de Djibouti. La compagnie Air-Djibouti reçu un Boeing et le président Saddam Houssein offrit un avion présidentiel au président Gouled.
25 millions de dollars de prêt faisait partie les accords conclus entre Djibouti et l’Irak. Ce prêt a été destiné à financer la construction à Ali Sabieh d’une cimenterie d’une capacité de 120000 tonnes. Il y’avait aussi un prêt qui devrait augmenter le capital de la banque nationale de Djibouti que l’Irak a octroyé.
Le Koweït et d’autres pays arabes ont aussi contribué au développement de Djibouti par la réalisation de différents projets telle que l’installation de portiques à conteneurs financée par l’État Koweïtien.
Rappel succinct de l’évolution de la langue arabe à Djibouti
La langue arabe revêt d’abord un caractère religieux ensuite elle devient une langue commerciale. Elle prend une autre dimension dans les années soixante-dix et s’érige en une langue essentielle à la diplomatie djiboutienne.
En 1947, Saïd Ali Coubèche devint représentant de C.F.S à l’assemblée de l’union française. Une année après son élection, il proposa au député Émile Martine une loi qui permet de voter à toute personne ayant la capacité de lire ou écrire la langue française et la langue arabe.
En août 1950, à la suite de la modification du régime électoral, de la compétence et de la composition du conseil représentatif de la C.F.S, Hassan gouled élut représentant de la C.F.S au Conseil de la République face à son concurrent mahamoud Harbi en 1952. « Après sa défaite Mahmoud Harbi voyagea dans les pays arabes, se rendant en Arabie saoudite, où il reçut des fonds, au Yémen où l’imam Ahmed l’accueillit, et à Aden, où il noua des contacts avec les syndicats».
Ali Coubèche a créé une école franco- arabe (école Coubèche) avant la deuxième guerre mondiale. Un nombre de 150 élèves de toutes ethnies confondues fréquentaient cette école d’ailleurs elle produisit l’élite djiboutienne. Deux ministres du gouvernement Gouled l’ont ainsi fréquentée (Mr Abdallah Kamil devenu premier ministres des affaires étrangères de Djibouti, il fut également Premier ministre en 1978 et M. Moumin Bahdon ancien ministre des affaires Étrangères). D’autres écoles arabes verront le jour durant la période coloniale telle que Al Madrasa Al Nagah et Al Madrasa al Fallah.
Les débuts de l’arabisation
Djibouti devrait adopter la langue arabe qui lui permettait l’intégration totale au sein de la communauté culturelle des pays arabes. Une nouvelle étape commence à Djibouti : entre la conservation de son héritage de plus d’un siècle et la confirmation de son identité culturelle.
Pour ce faire, le jeune état s’oriente vers un système de bilinguisme, tout en se référant au modèle tunisien.
En mars 1978, le ministre de l’Éducation nationale et de l’information, Houssein Hassan Banabila s’est rendu en Tunisie. L’objectif de cette visite était de discuter avec le gouvernement tunisien de deux sujets importants en l’occurrence le renforcement de l’arabe dans l’enseignement public et dans les médias. En ce qui concerne l’enseignement, Djibouti a mis en place un système de bilinguisme franco- arabe dès l’année scolaire 1978.
L’organisation Arabe pour l’Éducation, la Culture et les Sciences a pris en charge l’envoi de 80 enseignants tunisiens bilingues pour qu’ils prennent part à la politique du gouvernement djiboutien qui a décidé de promouvoir la langue arabe devenue la langue officielle à côté du français.
En mars 1979, Moumin Bahdon, ministre des Affaires étrangères, déclara « notre religion, notre position géographique, nos mœurs, notre appartenance à la Ligue arabe sont de toute façon des facteurs qui rendent indispensable l’enseignement de l’arabe dans nos écoles »
C’est ainsi que l’arabe est introduit dans l’école publique. Elle devint obligatoire à partir du CM1 et à raison de six heures par semaine, 4 heures dans le secondaire et 3 heures dans le lycée.
La promotion de la langue arabe à Djibouti dépassait le cadre de la politique du gouvernement. Certains pays arabes ont ouvert des écoles à Djibouti. Le gouvernement irakien a créé une école arabe gratuite deux mois après l’indépendance. Cette école proposait à la fois un enseignement général et aussi professionnel à l’issue duquel les élèves pouvaient continuer des études supérieures en Irak. Le programme scolaire étant celui de l’Irak, le gouvernement leur octroyait par la suite une bourse d’étude.
En 1981, l’Arabie saoudite a ouvert à son tour un Institut saoudien à Djibouti. Cet institut propose jusqu’aujourd’hui un enseignement secondaire et supérieur. L’admission se fait sur concours. L’école reçoit également des étudiants qui viennent de différents pays de l’Afrique de l’Est. L’Arabie saoudite accorde une bourse pour les élèves et étudiants fréquentant cet institut.
En 1995, l’Arabie saoudite a ouvert aussi une école saoudienne qui enseigne des matières scientifiques car l’Institut dispense la théologie et la littérature arabe.
En 1991 après la fermeture de l’école irakienne à cause de la guerre du golfe, certains commerçants djiboutiens ont ouvert une école Intitulée « école du Yémen » avec l’aide du gouvernement du Yéménite.
À la fin des années 80 jusqu’au début des années 90 plusieurs écoles arabes privées voient le jour telle que l’école du Fourqan, Al Irchad, Al falah. Ces écoles privées dispensent l’enseignement primaires et secondaires. Elles reçoivent des subventions des pays arabes.
Quarante-sept ans après l’adhésion de Djibouti à la ligue des nations arabes, il existe actuellement plus de 100 écoles arabes privées. L’État a promulgué dans un décret un baccalauréat arabe national au même titre que celui en français.
L’arabe est enseigné dès la 3ème année de l’école primaire
La loi portant organisation du ministère de l’éducation en 2012 crée un département du développement de la langue arabe. Ce département est chargé de mettre en œuvre et de suivre la politique de valorisation de la langue arabe et de son usage dans l’administration.
Un décret exige en 2014 que les documents d’équivalence des diplômes soient libellés en français ou en arabe.
Conformément à la loi d’orientation de l’Éducation, l’enseignement en français et/ou en arabe doivent se faire de façon concomitante dans tous les établissements scolaires
Ainsi donc le gouvernement djiboutien a fourni beaucoup d’efforts pour se conformer aux exigences de la Charte de la Ligue Arabe qui oblige tous les États membres à «s’arabiser ».
Qu’en est-il de l’arabe dans la société djiboutienne de nos jours ?
L’arabe dans l’administration djiboutienne
La langue arabe a traversé différentes étapes à Djibouti. Il y eu d’abord une époque où l’arabe était très marginalisé et relégué au dernier plan face au français. En dépit de l’officialisation de l’arabe dans la Constitution le français reste la langue de l’administration. Les perspectives pour les arabophones n’étaient pas réjouissantes. Il fut également une autre période ou l’enseignement arabe était une seconde chance pour certains enfants qui décrochaient de l’école de la république.
J’entendais souvent une expression en langue Somalie qui disait « ciiyalamalcaamadaasadciiyalaskoledawlad » c’est à dire l’école publique prépare l’élite et les futurs dirigeants et ceux qui fréquentent l’école arabe n’ont pas d’avenir. C’est seule l’école publique permet d’ouvrir les portes d’un avenir prometteur.
Ces idées reçues sont dépassées après 47ans de l’adhésion de Djibouti à la ligue des États arabes
On peut parler des défis de la langue arabe qui seront à relever et surtout un bilinguisme non-assumé, mais, dans l’ensemble, de nos jours, l’apprentissage de l’arabe contribue à la formation des intellectuels djiboutiens. Il existe des médecins arabophones djiboutiens, des colonels dans l’armée, police et gendarmerie, voire de généraux. Plusieurs Ministres arabophones dans le gouvernement.
Comme cité plus haut, 9 de 22 ambassadeurs djiboutiens à l’étranger sont arabophones ou bilingues. Finie une époque où les non arabophones étaient ambassadeurs dans les pays arabes.
Djibouti est un carrefour multiculturel où les mythes s’éclosent avec le français, l’arabe et d’autres langues locales. Ces deux langues officielles se marient et se conjuguent dans cette contrée du monde. Aujourd’hui le bilinguisme s’épanouit, bien que les stigmates et ce sentiment d’infériorité de la langue arabe, se font encore ressentir car nous observons des arabophones optés pour leurs progénitures à l’enseignement publique.
A l’inverse il existe des francophones qui inscrivent leurs enfants dans les écoles arabophones afin que leurs enfants aient un enseignement arabe.
Beaucoup de réformes ont été faites par le président Ismail Omar Guelleh. Plusieurs décrets et décisions ont été prises par son gouvernement, comme celui ordonnant l’égalité de statut entre tous les enseignants quelques soient la provenance des diplômes.
Un autre décret oblige tous les départements ministériels de recruter des arabophones
Les lois sont rédigées en français mais elles sont enregistrées et publiées en français et en arabe comme stipulé dans l’article 89 de la constitution
Aujourd’hui la langue arabe est plus ou moins présente dans la vie publique, dans les médias et dans le monde des affaires à Djibouti
Arabophonie et francophonie
Ce processus d’arabisation promu par le président de la République,son excellence Ismail Omar Guelleh depuis qu’il est à la tête du pays, permet à la langue arabe de retrouver ses lettres de noblesse. Longtemps reléguée au second plan, la langue arabe dans son aspect socioculturel a su trouver sa place dans la société djiboutienne. Les Djiboutiens n’hésitent pas à choisir l’enseignement arabe pour leurs enfants. Est-ce à dire que le français recule ? L’erreur serait de croire que les deux langues s’opposent ou bien que l’une est plus importante que l’autre. Cette question est pourtant tranchée par la Constitution qui met les deux langues sur le même pied d’égalité.
Notre appartenance à une communauté d’États arabes rend nécessaire et indispensable l’apprentissage et la maitrise de la langue arabe dans notre pays. Djibouti a sans doute compris que cette double conscience que forge le bilinguisme permet au citoyen une ouverture sur le monde actuel. Que partageons-nous concrètement avec cette communauté d’États arabe si à chaque fois que nous sommes conviés comme pays membre nous sommes dans l’incapacité de communiquer avec nos pairs ? Dois-je rappeler ici le ridicule auquel s’exposent nos délégations lorsqu’elles se rendent à des évènements interarabes et communiquent dans une autre langue.
Ainsi en sortant de ce bilinguisme symbolique et en empêchant l’insécurité linguistique Djibouti aurait tout à gagner en soutenant les projets de promotion de la langue arabe et en multipliant la création d’instituts d’enseignement bilingue.
Par ailleurs, il serait indispensable d’exiger des fonctionnaires de l’administration de justifier d’un minimum de connaissance en langue arabe tout comme les arabisants devraient pouvoir maitriser la langue française. Aussi, il serait important de garantir pour chaque djiboutien arabisant ou francophone de pouvoir être servit dans les différentes administrations dans la langue de leur choix. Un adage égyptien dit : la terre parle arabe, nous disons donc que Djibouti est une terre bilingue. Le bilinguisme est un véritable vecteur de réussite professionnelle sur le plan national et internationale. Il est donc indéniable que l’arabeconstitue un axe de développement majeur pour notre économie au regard du déplacement du centre de gravité du monde vers les pays arabes tant sur le plan commercial que stratégique. Rappelons que l’arabe est parlé par quelques cinq cents millions de personnes (5eme langue parlée dans le monde) et fait partie des langues officielles de l’ONU. Autant pour s’ouvrir vers de nouvelles cultures que pour développer ses affaires, l’arabe est aussi une langue d’échanges internationaux.
Pour relever le défi du bilinguisme le gouvernement a créé des écoles bilingues afin de promouvoir le multiculturalisme.
En 2009, le gouvernement ouvre une école bilingue à Arta et envisage de multiplier l’enseignement de ce type à travers des projets financés par la banque islamique de développement selon le ministère de l’éducation.
En continuant sur cette voie, Djibouti garantie la promotion du bilinguisme comme la clé de l’avenir pour les générations futures.
La connaissance d’une langue ne veut en aucun cas supposer l’exclusion d’une autre et le gouvernement valorise les compétences humaines indépendamment de la langue.
Au terme de cet article, force est de constater que la langue arabe, telle qu’elle a évolué à Djibouti, a contribué à l’édification et la consolidation des différends valeurs que défend notre pays. Dorénavant l’arabe n’est pas une langue étrangère, mais la langue du pays qui s’épanouit dans un espace ouvert sur le reste du monde. In fine, face à la mondialisation des cultures Anglo-saxonnes le bilinguisme à Djibouti peut-il en survivre ?
En somme, le bilinguisme que nous recommandons peut-il être le creuset d’une république multiculturelle voire multilingue ?
Bibliographies
-J-F,Nodinot, 22 États arabes, une nation, Paris, 1980.
-PH. Oberlé et P. Hugot, Histoire de Djibouti. Des Origines à la République, Éditions
Présence Africaine5 mars 1997.
-M. Aubry, Djibouti : bibliographie fondamentale, Paris l’harmattan, 3 mi 2000.
-I.Dangoura, l’histoire de l’arabe comme matière à enseigner : et comme langue d’enseignement/apprentisaage dans le système éducatif sénégalais de l’indépendance à nos jours, Éditions universitaires européennes, 13 aout 2021.
-M. Rainbaud, le Soudan dans tous ses États, Karthala, 2019.
-A. Kerdoun, la coopération arabo-africaine : dimensions et perspectives, Berger-Levrault, Paris, 1987.A. Rouaud, pour une histoire des arabes de Djibouti,1896-1977, Cahiers d’études
Africaines, 1997.
-G.Farah, La république de Djibouti : naissance d’un État, chronologie juin 1977-1981, Tunis Imprimerie Officielle, 1982.
-D. hamady, Djibouti, une sécurité pour la Mer rouge, Égypte, 1977.
-Périodiques : La Nation, al Qarni et La Clé du Moyen Orient
ALI ABDILLAHI HASSAN,
diplomate et spécialiste du monde arabe et musulman