
Le rôle des emporia commerciaux dans le système-monde : Un regard renouvelé sur Djibouti, cité-État et ville-port stratégique
Publié aux éditions L’Harmattan sous le titre original The Role of Commercial Emporia in the World-System : Djibouti, City-State and City-Port, in an Environment at the Crossroads of Continents, l’ouvrage de la chercheure Dr Zohra Mohamed Omar aborde la question des entrepôts ou emporia de la région à travers une perspective historique et géostratégique. Il propose une lecture approfondie de l’évolution des dynamiques portuaires régionales depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours, tout en s’inscrivant dans une approche conceptuelle innovante mêlant histoire, géopolitique, économie politique du développement et relations internationales.
Dr Zohra Mohamed Omar est chercheure spécialisée dans la Corne de l’Afrique, en particulier sur la République de Djibouti. Elle travaille à l’Institut d’Études Politiques et Stratégiques, rattaché au Centre d’Études et de Recherches de Djibouti (Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche). À travers cet ouvrage, elle interroge le rôle des villes-ports stratégiques dans un système-monde mondialisé, en prenant Djibouti comme étude de cas centrale.
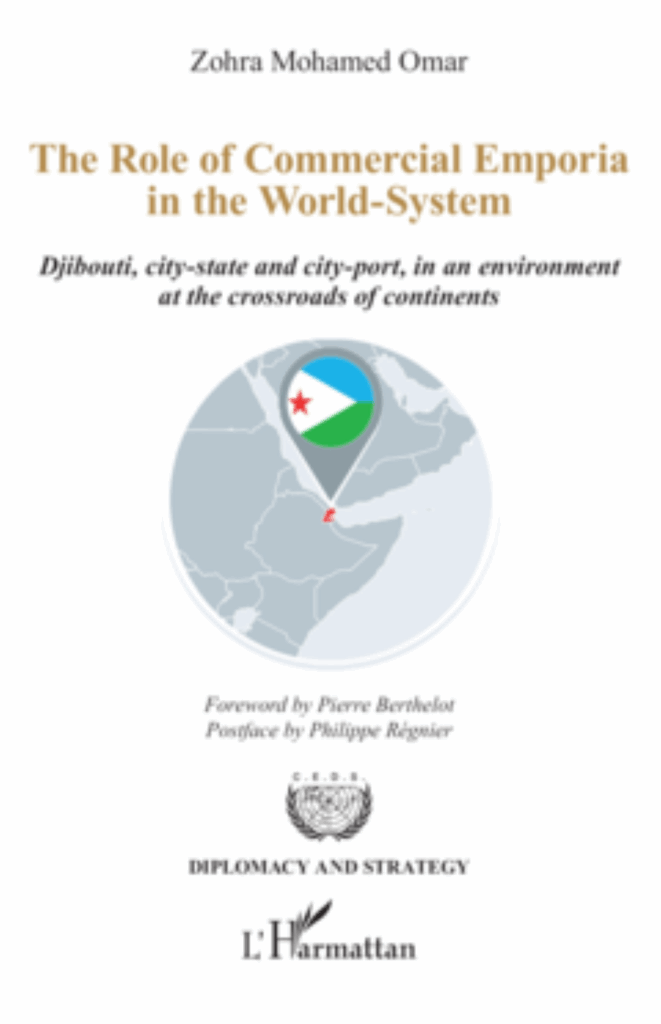
Une perspective théorique renouvelée sur les emporia
Dans cet ouvrage, l’auteure redéfinit la notion d’emporium, au-delà de sa définition classique de comptoir ou entrepôt commercial. Elle en fait une véritable grille d’analyse des rapports entre une ville-port, son arrière-pays immédiat, et son insertion dans les circuits économiques mondiaux.
À l’image de Venise, Suakin, Zeyla ou encore Singapour, Djibouti est analysé comme un nœud de flux, un carrefour stratégique de la mondialisation, dont la survie repose sur sa capacité à s’adapter à des contextes géopolitiques instables.
L’approche théorique est double : d’une part, elle s’appuie sur la théorie du système-monde développée par Wallerstein, pour comprendre la position semi-périphérique de l’Afrique de l’Est au sein des échanges globaux ; d’autre part, elle convoque les outils du néo-institutionnalisme, pour explorer le rôle structurant des institutions locales dans l’efficacité économique et logistique des emporia contemporains.
L’Emporium de Djibouti : une perspective historique
L’ouvrage commence par une approche théorique des emporia commerciaux, en montrant leur rôle dans les échanges mondiaux et l’importance stratégique des villes-ports. Il s’appuie sur les théories de la dépendance et du néo-institutionnalisme pour analyser ces espaces comme des liens entre le local et le global. Ce n’est qu’ensuite que l’auteure retrace l’histoire des échanges dans la région, en mettant en lumière le rôle de Djibouti et de la région dans les réseaux marchands entre Afrique, Asie et Moyen-Orient. Dès l’Antiquité, des réseaux de navigation relient les côtes arabes et africaines. Ces réseaux locaux ont progressivement été intégrés à des circuits commerciaux plus vastes, portés par des transformations géopolitiques majeures : l’émergence de puissances maritimes régionales, le commerce de la soie et des épices, ou encore l’expansion de l’islam. Dans cecontexte, la Chine apparaît comme un acteur structurant dans les échanges transcontinentaux, dès l’époque Tang et Song. Parallèlement, l’Afrique orientale s’intègre progressivement au système-monde comme zone de semi-périphérie, grâce à ses ports de la mer Rouge et de l’océan Indien. Des sites comme Zeyla, Tadjourah ou les îles Dahlak témoignent d’une culture du commerce ancienne, fondée sur l’intermédiation, l’hybridité culturelle et les réseaux diasporiques. Cette historicité éclaire la place contemporaine de Djibouti, perçue non pas comme un point de rupture, mais comme l’héritière moderne de cette dynamique afro-eurasienne, aujourd’hui renforcée par les nouvelles routes commerciales maritimes.
Entre continuités historiques et mutations contemporaines
L’analyse du cas djiboutien permet de penser la transition entre les emporia précoloniaux et les hubs portuaires contemporains. La création de Djibouti comme ville-port à la fin du XIXᵉ siècle, sous l’impulsion française, répond à une logique impériale : contrôler le passage stratégique du détroit de Bab el-Mandeb, rivaliser avec Aden, et constituer un débouché pour l’arrière-pays abyssin.
Depuis l’indépendance, la trajectoire de la ville urbaine s’est inscrite dans une logique d’adaptation aux mutations de l’économie mondiale. Djibouti développe sa fonction de ville-port selon trois dimensions :
• Sa centralité portuaire, notamment comme plateforme de transit pour les marchandises éthiopiennes ;
• Sa nodalité géopolitique, dans une région où cohabitent influences américaines, françaises, chinoises, turques, japonaises … ;
• Sa réticularité commerciale, qui permet son insertion dans les routes maritimes de la triade, en lien avec les corridors africains et moyen-orientaux.
Ville, port et souveraineté dans un monde fragmenté
Un des points de l’ouvrage est l’analyse des tensions entre les dimensions urbaines, portuaires et politiques du développement de Djibouti. La ville connaît une pression démographique et urbaine croissante, qui se superpose à l’extension du domaine portuaire et logistique. Cela pose la question de la gouvernance de l’espace, du foncier, des flux migratoires, mais aussi de la sécurité et de la diplomatie.
La ville devient alors un espace politique à part entière. Djibouti incarne une forme de cité-État contemporaine, où l’équilibre entre ouverture et souveraineté est constamment renégocié. L’internationalisation du territoire, à travers les bases militaires étrangères, les investissements chinois (zone franche, train Addis-Djibouti), ou les partenariats logistiques, montre bien les opportunités mais aussi les risques liés à cette stratégie.
L’emporium djiboutien comme laboratoire géopolitique
Dans un monde multipolaire et instable, Djibouti offre un laboratoire stratégique. L’État djiboutien a mis en place une diplomatie pragmatique et multidimensionnelle, fondée sur une identité africaine et arabe affirmée, une neutralité active et une capacité à jouer les équilibres entre puissances. En cela, l’ouvrage montre que Djibouti n’est pas seulement un acteur passif de la mondialisation, mais un agent structurant des dynamiques régionales. L’intégration régionale, en particulier avec l’Éthiopie, est un axe fondamental. Malgré la dépendance commerciale, cette relation tend vers une interdépendance stratégique, renforcée par des projets conjoints et la complémentarité logistique. Djibouti se positionne également comme un point d’entrée pour le COMESA et les flux vers l’Afrique centrale.
Le travail de Zohra Mohamed Omar ne se contente pas de dresser un tableau historique ou théorique. Il propose également une réflexion sur la capacité des emporia modernes à survivre dans un monde multipolaire instable, où les routes maritimes, les alliances diplomatiques et les équilibres régionaux sont en constante mutation.
Ce que nous enseigne cet ouvrage, c’est qu’un emporium du XXIe siècle ne peut exister que par sa capacité à maîtriser la complexité des flux, à négocier les asymétries de pouvoir, et à renforcer ses institutions pour affronter les chocs globaux. En cela, Djibouti apparaît comme un laboratoire stratégique, autant qu’un cas d’école en science politique, en géographie urbaine et en relations internationales.
Conclusion : Djibouti, archétype d’un emporium du XXIe siècle
The Role of Commercial Emporia in the World-System est une contribution majeure à la compréhension des dynamiques portuaires, des cités-États modernes et des relations entre commerce, souveraineté et géopolitique. À partir du cas de Djibouti, l’ouvrage offre une lecture globale, ancrée dans la longue durée, des transformations du commerce mondial et des enjeux contemporains liés aux zones littorales stratégiques.
Dans une époque marquée par la reconfiguration des routes maritimes, la montée des tensions géopolitiques et la nécessité de sécuriser les chaînes logistiques, Djibouti incarne un modèle hybride, à la fois héritier des emporia antiques et acteur de la mondialisation du XXIᵉ siècle. C’est ce modèle que cet ouvrage nous invite à découvrir, à comprendre et à penser, bien au-delà du simple cas djiboutien.














































