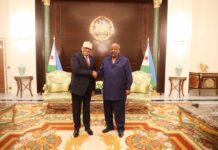Il fut un temps où la parole publique s’acquérait au prix de la compétence et du mérite. Aujourd’hui, elle s’arrache en quelques clics. Elle s’étale sans filtre ni fond sur les nouvelles arènes du discours globalisé : Facebook, X, Youtube, Tiktok, Instagram… et j’en passe. Avec l’émergence des réseaux sociaux, l’expression n’est plus un privilège du savoir ou de l’expérience. Elle est devenue une foire ouverte où le réfléchi se confond au venimeux et l’intérêt général au défouloir personnel.
Nos pays africains, en particulier, paient cher cette révolution incontrôlée de la parole. Car c’est souvent de loin, à des milliers de kilomètres, depuis des salons en Occident, que fusent les jugements lapidaires et les analyses bâclées. La diaspora, jadis moteur d’idées fructueuses et de solidarité constructive, voit une partie d’elle-même se transformer en caisse de résonance du ressentiment. À force de posts rageurs, de vidéos approximatives, de threads gonflés d’égo, certains de ses membres ont troqué l’engagement pour le buzz, la nuance pour l’anathème.
Ce sont parfois ceux qui ont quitté leurs pays d’origine depuis des décennies, sans plus y remettre les pieds, qui se donnent le droit de dicter la marche à suivre à ceux qui, chaque jour, vivent, travaillent et bâtissent ici. Et les réseaux sociaux, dans leur logique virale, érigent ces voix en paroles coraniques. Non parce qu’elles sont fondées, mais parce qu’elles sont les plus bruyantes.
Entendons-nous bien : la critique n’est pas un problème. Ce qui l’est, c’est l’illusion de savoir sans savoir. C’est l’absence de contexte et le mépris condescendant vis-à-vis des réalités africaines. La distance géographique devient trop souvent une distance morale, où tout est jugé avec les lunettes déformantes du « confort » occidental. On oublie que bâtir une nation, c’est aussi composer avec son histoire, ses contraintes et ses équilibres.
Le débat public africain mérite mieux que ce vacarme numérique où la superficialité le dispute à la mauvaise foi. Il a besoin de hauteur et de contradiction féconde, pas de procès d’intention permanents. Il a besoin de voix qui éclairent, pas qui enflamment.
Il serait cependant erroné de porter tout le blâme sur les réseaux sociaux en tant que tels. Après tout, ils ne sont qu’un outil. Le défi, c’est l’usage qu’on en fait. À nous, donc, d’y reprendre le contrôle du récit. Non pas en étouffant les critiques légitimes, mais en exigeant qu’elles soient portées par ceux qui aiment assez leurs pays pour les comprendre, ceux qui aiment assez leurs peuples pour leur parler avec respect. Et non par ceux et celles qui détestent la vérité au point qu’ils la sacrifient à la viralité. Car la parole libérée n’a de sens que si elle est aussi une parole responsable.