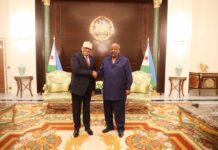Depuis plus de sept décennies, le conflit israélo-palestinien incarne l’échec répété du droit face à la force. Bombardements, occupation, colonisation, vetos: un engrenage de violations impunies s’enracine, sous le regard complice des grandes puissances. Alors que les principes du multilatéralisme s’effondrent, la Palestine devient le miroir d’un monde où l’injustice s’institutionnalise et où le silence devient stratégie.
Le bombardement récent sur le sol qatari il n’y a pas si longtemps que cela, attribué à Israël, a marqué un nouveau tournant alarmant dans un conflit déjà saturé de violations du droit international. En frappant au-delà des territoires palestiniens occupés, Israël étend encore le champ des hostilités et piétine une fois de plus les principes fondamentaux qui régissent les relations entre États.
Cet acte, que de nombreux intellectuels considèrent comme illégal, vient allonger la liste déjà conséquente des infractions documentées, sans qu’aucune sanction internationale ne vienne rappeler les règles du droit.
Si on fait un retour dans le temps, depuis 1948 et la tragédie de la Nakba, le conflit israélo-palestinien est jalonné de transgressions du droit international. Le plan de partage imposé par l’ONU, la guerre de 1948, puis l’exode forcé de centaines de milliers de Palestiniens ont ouvert une époque où la force a systématiquement prévalu sur la légalité.
La guerre des Six Jours en 1967 a marqué un tournant décisif: occupation de la Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est, colonisation ininterrompue, transferts de population prohibés par les Conventions de Genève, et édification d’un mur de séparation jugé illégal par la Cour internationale de justice. Chaque élément de ce dossier contribue à dresser un constat accablant.
Pourquoi ces violations demeurent-elles sans conséquences ? Parce que les considérations stratégiques l’emportent systématiquement sur les principes juridiques.
Les États-Unis, par le biais de leur droit de veto, bloquent régulièrement toute résolution contraignante au Conseil de sécurité. L’Europe, quant à elle, s’en tient à des déclarations d’intention, paralysée entre sa mémoire de la Shoah et ses intérêts diplomatiques et économiques au Proche-Orient.
Cette inertie selon certains penseurs équivaut à une complicité tacite. Elle vide de leur substance les fondements mêmes de la Charte des Nations unies et fragilise la légitimité du système multilatéral.
L’attaque du Hamas en octobre a servi de justification à une riposte israélienne d’une ampleur inédite. Les bombardements massifs, la destruction d’infrastructures civiles, les milliers de morts et les déplacements forcés à Gaza relèvent d’une logique de punition collective clairement interdite par le droit international humanitaire.
La disproportion flagrante entre la menace et la réponse militaire suffit à elle seule à illustrer l’effondrement du cadre juridique dans ce conflit.
Ni la Cour internationale de justice ni le Conseil de sécurité ne semblent aujourd’hui en mesure de faire appliquer leurs propres décisions. Les résolutions s’empilent, sans effet concret, bloquées par des vetos ou des intérêts politiques contradictoires. Cette paralysie nourrit un sentiment d’impunité, renforce le cycle de la violence et mine la confiance dans les institutions internationales.
Soixante-quinze ans après 1948, le peuple palestinien reste privé de ses droits fondamentaux : souveraineté, territoire, dignité. L’inaction prolongée de la communauté internationale a transformé ce conflit en l’un des symboles les plus flagrants de l’échec du droit international contemporain.
Du bombardement du Qatar à l’occupation continue de la Cisjordanie, de l’exode de la Nakba aux dévastations de Gaza, le fil conducteur reste le même: un mépris persistant du droit international et un silence occidental devenu insoutenable. Chaque inertie diplomatique se paie en vies humaines, et creuse un peu plus le fossé d’un conflit dont l’issue, sans sursaut collectif, semble chaque jour plus incertaine.
Que deviennent les hommes en fermant les yeux ainsi ? Ils ne deviennent pas seulement aveugles : ils deviennent responsables. Car ne pas voir, quand on peut voir, c’est choisir. Et choisir de détourner le regard, c’est abandonner ce qui fait de nous des êtres moraux : la capacité de dire non à l’inacceptable.
En refusant de regarder, les hommes érodent ce qui les élève au-dessus de la violence brute le sens du juste, du vrai, du commun. À force de silence, l’humanité cesse d’être une promesse partagée, pour devenir une frontière entre ceux qui souffrent… et ceux qui oublient.
Said Mohamed Halato