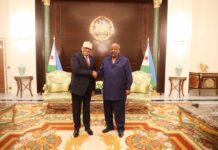Le pays de Pount occupe une assez spéciale dans le domaine de l’égyptologie, car ce territoire et ses habitants entretenaient un lien fraternel avec la civilisation de Kamit. Pount, également nommée « ta Natar (« la terre Divine»), était considérée par les kamitiens comme une terre sacrée et ancestrale.
Difficilement accessible en raison de la distance qui les séparait, plusieurs dirigeants, dont la reine Hatshepsout, avaient réussi à maintenir cette relation fraternelle en envoyant des expéditions navales et terrestres qui ramenaient à leur retour les « merveilles » de Pount (encens, oliban, gomme arabique, myrrhe, or, bois d’ébène, bois de cannelle, khôl, animaux). L’expédition était même accompagnée d’habitants de Pount qui partaient découvrir la vallée du Nil.Les archives de Kamit démontrent aussi que les chefs traditionnels pountites se rendaient également là-bas pour des visites officielles. De nos jours, les égyptologues n’arrivent pas à s’accorder sur l’emplacement de Pount, ni sur l’identité de ses habitants, faute de preuves archéologiques. La plupart des égyptologues situent Pount vers les côtes du nord de la Corne de l’Afrique entre l’Érythrée et la région autonome du Pountland.
En outre, la récente découverte d’une abasourdissante proximité linguistique entre la langue des hiéroglyphes et les langues couchitiques, le somali étant le principal sujet d’étude, nous pousse à chercher les traces de Pount au sein de la Corne de l’Afrique, notamment à Djibouti.
Tout d’abord, il faut savoir que le pays de Pount était constitué de plusieurs régions, dont seulement deux étaient connues de nom. Il y avait la région de «Kheetiyo Canatiyo », qui se traduit par « arbres d’oliban » (un arbre se dit « kheet » en kamitien et « geed » en somali). Il y avait aussi la région aurifère de « Camo » (en kamitien comme en somali, le « c » se prononce comme la lettre arabique « ain »). Si la région des arbres d’oliban correspondrait plus au littoral nord somali (Somaliland et Puntland) entre Zeila et le Cap Gardafui), une partie de la région de « Camo » pourrait correspondre à l’actuel territoire de Djibouti. Il existe un incroyable site datant d’environ 8 000 ans, bien avant l’époque des toutes premières dynasties Kamit et du pays de Pount. Situé sur le massif de Makarrassou de la région de Tadjourah, il est le plus important du pays et l’un des plus importants sites d’art rupestre d’Afrique de l’Est. Inscrit dans la liste indicative du patrimoine mondial UNESCO, il offre un spectacle impressionnant de 3 kilomètres de gravures rupestres qui témoignent d’une forte activité humaine sous un climat beaucoup plus clément comparé à l’aridité actuelle et la chaleur intense qui sévit à Djibouti.
On peut y observer des milliers de scènes détaillées d’hommes pratiquant la chasse, le combat et des rituels, ainsi que des animaux sauvages (éléphants, girafes, hippopotames, rhinocéros, antilopes) et domestiques.
En 2021, Ibrahim Dabale Loubak, gardien du site d’Abourma, expliquait que cet endroit était connu par ses aïeux qui lui avaient transmis ce savoir.
En 2005, Ibrahim guida la toute première équipe d’archéologues à s’y rendre. L’archéologue Benoît Poisblaud expliquait que «Abourma est une continuité, sur plusieurs millénaires, de passages, de gravures, réalisées par des peuples très différents : chasseurs, éleveurs, et ceux qui ont suivi… »
Après avoir sondé plusieurs autres sites situés à Djibouti, il avait noté l’abondance des tessons de céramique de même type et des sépultures bâties de la même manière.
Tous ces indices lui ont permis de mettre en évidence la présence à Djibouti d’une civilisation qu’il a baptisée « Asgoumhatienne » (du nom du site archéologique d’Asgoumhati) et qui aurait prospéré il y a environ 5 000 ans. Tout porte à croire alors que cette civilisation faisait partie intégrante du pays de Pount et probablement de la région que les kamitiens appellaient « Camo ».
De plus amples recherches seront nécessaires afin d’en savoir davantage sur notre lointain passé.
Abi-Paul Laclé