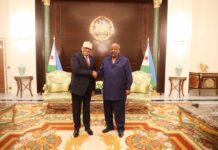Écrivain et cinéaste africain, Ousmane Sembène demeure une figure de proue dans le champ de la création aussi bien littéraire que cinématographique. Une figure prolixe dont l’engagement pour la réfection du patrimoine culturel endogène affleure dés les premières œuvres dans un processus de vernacularisation qui accorde une grande place au peuple et à ses représentations. Le présent article retrace son double parcours et évoque la dynamique de cette interférence incessante et ses ressorts que vectorise toujours cet élan pour les cultures endogènes qui s’effritent et la célébration constante de ce continent et ses peuples. Loin de l’idée de crispation identitaire et de repli sur soi, ces initiatives mettent en scène une reconquête et une reterritorialisation du savoir et des valeurs ancestrales en opposition aux discours monolithiques coloniaux et néocoloniaux.
En 1966, Ousmane Sembène, auteur et cinéaste autodidacte sénégalais, participe au premier Festival Mondial des Arts Nègres avec deux films : Niayé, un court métrage adapté de sa nouvelle Véhi-Ciosane (Présence africaine, 1966), consacrée comme le meilleur ouvrage qu’ait jamais donné un écrivain africain, et La Noire de, film tiré de son recueil de nouvelles intitulé Voltaïques (Présence africaine, 1962). Ce dernier lui a valu de nombreuses consécrations, aussi bien lors du Festival, où il reçoit L’Antilope d’Argent et le prix Jean Vigo, qu’à l’échelle même du continent quand, dans le courant de cette même année, il obtient le Tanit d’Or à Carthage.
C’est précisément de 1962 que datent les prémices de cette interférence incessante entre œuvre littéraire et œuvre cinématographique qui caractérise l’activité d’Ousmane Sembène, certains aspects de son écriture trouvant à se réinvestir chez le Sembène cinéaste.
En 1962, voilà plus de dix ans qu’Ousmane Sembène s’est attaqué à l’art d’écrire. Sa première publication remonte à 1956, où il fait paraître un roman largement autobiographique où, en traitant de son expérience de docker à Marseille, il trouve moyen d’aborder des questions relatives à l’immigration et à la visibilité des minorités dans la société française de l’époque, souvent traitées alors avec condescendance. L’année 1957 voit la naissance de son second opus, Ô Pays, mon beau peuple, l’histoire d’un jeune Africain, Oumar Faye, que ses attaches avec l’Occident – à commencer par son mariage – n’ont pu retenir de répondre à l’appel de sa Casamance natale. Rien n’y est simple pour autant, puisque toutes ses tentatives pour dépasser les difficultés du quotidien en revivifiant la vie villageoise se soldent par un échec, sa fin tragique valant paradigme pour tous les obstacles inhérents aux retours aux sources.
À tous égards, il s’agit là d’une œuvre où Sembène a cristallisé une grande partie de son parcours, de sa sensibilité et des luttes qui l’ont animé1. Suivent Bouts de bois de Dieu2, qui ont aujourd’hui statut de classique francophone. Il y peint avec une verve incomparable la véritable épopée menée, plusieurs mois durant, par des hommes et des femmes du peuple lors de la fameuse grève des cheminots de 1947, à laquelle il avait lui-même pris une part active. Une grève où les idées paternalistes sur le nègre bon enfant jusque-là défendues par les colons ont été mises à mal et qui a marqué, sur le plan esthétique, un moment-clé dans la production romanesque de Sembène dont rend bien compte ce roman-repère qui chante le pouvoir de la lutte, à l’orée des indépendances.
Issu d’un milieu populaire, fils d’un père pêcheur de Casamance, Ousmane Sembène a déserté les bancs de l’école à l’âge de 13 ans, après qu’il eut giflé son instituteur, Paul Péraldi, qui avait porté contre lui des accusations mensongères. Après quoi il a tâté de diverses professions – mécanicien, maçon, ouvrier chez Citroën, fondeur, tirailleur (au 6e régiment, de 1942 à 1946), docker, à Marseille. C’est dire qu’Ousmane Sembène appartenait originellement à cette catégorie de déshérités qu’il n’a cessé de représenter à travers ses œuvres comme l’authentique visage de l’Afrique, qu’elle soit coloniale ou postcoloniale. Qu’il s’agisse des événements ou d’un choix de société, sa prise de position est explicite, quand son accession à la culture et à l’écriture font de lui le chantre de ceux qui n’ont pas de bouche, selon une expression de Césaire on ne peut plus parlante, elle.
Un parcours d’autodidacte
Pour autant, le bilan que tire Ousmane Sembène de son incursion dans le champ littéraire est, pour partie au moins, amer et son avènement au cinéma peut se lire comme une tentative pour étendre les limites de ce mode de communication, reconnu comme par trop intransitif dans le contexte de la société postcoloniale africaine en voie de construction. C’est à cette aune, en effet, qu’il faut rapporter sa double carrière créative dont le partage éclaire un parcours d’autodidacte que guide une prise de conscience : à l’orée des indépendances, la littérature africaine n’est que peu fréquentée par des peuples autochtones laissés pour compte. Partant, elle ne participe que partiellement à la construction d’une identité nationale et à la réfection du patrimoine culturel. Pour le dire clairement, elle s’adresse à une intelligentsia bourgeoise postcoloniale coupée du peuple et tournée vers un médium linguistique dont la majorité n’a pas la maîtrise : le français. Cherté des livres et analphabétisme oblige, la littérature, qui s’exprime essentiel-lement en langue européenne, diffuse dans des circuits à la fois institutionnels et minoritaires : collèges, lycées, universités. L’accès aux livres relève forcément du privilège réservé à certaines catégories sociales et aux centres urbains, soient des univers cloisonnés, rigides et souvent exclusifs, qui contrastent avec la fluidité orale des masses populaires et avec leur ancrage linguistique endogène et traditionnel. D’ailleurs, dans ses romans comme dans ses films, seuls les bureaucrates et ceux qui se prétendent « évolués », symboles du colonialisme ou du néocolonialisme, arborent le français comme signe discriminant de leur appartenance à la civilisation.
Réconcilier peuple et littérature, peuple et idées
Si bien que, si le monde élitiste de la littérature exclut de facto le peuple majoritairement analphabète, c’est par le truchement du cinéma qu’Ousmane Sembène entend réconcilier peuple et littérature, peuple et idées nouvelles pour le réveil d’une Afrique populaire qui s’autocritique et se jauge. Le passage est médité, qui compte remédier à la lecture et à ses exigences en lui substituant une visualisation supposée plus accessible, et remédier à l’obstacle de la langue exogène en faisant le choix d’une vernacularisation des œuvres dans une démarche concertée qui n’ignore pas les codes sémiotiques issus du terroir. C’est postuler que, plus peut-être que les Lettres, fort de l’impact et de la puissance que revêt l’image dans ces sociétés de l’oralité, le cinéma se prête à la restitution d’une image de soi qui puisse contrebalancer celle véhiculée par l’Occident durant la période coloniale. De fait, l’engouement des couches populaires pour le cinéma est avéré. Au sein des anciennes colonies, le Sénégal compte, avec l’Algérie, parmi les marchés les plus florissants, sous l’égide de deux compagnies, la Comacico et la Secma. Cet engouement pour le septième art, Ousmane Sembène est d’autant plus en mesure de le mesurer qu’il l’a personnellement éprouvé : en témoignent, très tôt, ses escapades répétées à Dakar où l’attirent les salles obscures, qu’il ne peut fréquenter qu’en resquillant.
Avant même qu’il n’entame sa carrière de cinéaste, ses premiers écrits enregistrent cette passion, et jamais l’obsédante référence au cinéma ne se démentira dans son œuvre littéraire. Mais, de même qu’il y a littérature et littérature, il y a cinéma et cinéma, et celui qui a l’assentiment d’Ousmane Sembène se sépare radicalement du cinéma de pur divertissement qui confine à l’aliénation pour se tourner résolument vers le cinéma militant :
Sur les écrans d’Afrique noire, ne se projettent souvent que des histoires d’une plate stupidité, étrangères à notre vie. Pour nous, Africains, le problème cinématographique est aussi important que de construire des hôpitaux, des écoles, donner à manger à nos populations. L’important est pour nous d’avoir notre cinéma : c’est-à-dire de se revoir, de se saisir, de se comprendre soi-même par le miroir de l’écran3.
6C’est là condamner la forme dominante de la production du genre, un cinéma où prévaut la production étrangère, qu’elle soit française, américaine ou encore arabe ou indienne, qui projette pour le jeune public des valeurs d’importation et le pousse à l’assimilation de modes de vies qui lui sont étrangers. Les écrans africains ne sont alors en rien différents de leurs homologues européens, qui fonctionnent comme des annexes d’Hollywood : sous couvert d’évasion, s’y jouent les nouvelles modalités de l’acculturation et de la dépersonnalisation, qui se parent des séductions de la mimésis.
Sembène, dans une critique lucide et décapante, dresse un portrait impitoyable de ces « évolués » qui se détournent des valeurs autochtones en embrassant jusque dans leurs choix vestimentaires des valeurs qui tranchent avec le contexte africain et le ravale au rang d’espace inadapté aux exigences modernes. Ainsi Mbaye, dans Le Mandat (1968), « était de la nouvelle génération “Nouvelle Afrique”, comme on dit dans certains milieux : le prototype, mariant logique cartésienne, le cachet arabisant et l’élan atrophié du négro-africain »4. Quant à sa femme, en véritable assimilée, elle arbore, dans une imitation explicite des femmes occidentales, une perruque à la B.B. Dans Le Mandat comme dans Les Bouts de bois de Dieu, Ousmane Sembène flétrit ce cinéma de pacotille, exogène, pollueur des valeurs autochtones et semeur d’illusions, dont il donne à voir les effets pervers à travers le personnage d’Ambroise, le photographe malfrat, consommateur assidu de ces productions, dont l’avilissement est donné pour la résultante de son accoutumance :
Ambroise débitait tout cela dans toutes les langues. Sa grande consommation de romans policiers, sa fréquentation assidue des salles de cinéma où étaient projetés des déchets de films, français, américains, anglais, indiens, arabes rendait son vocabulaire fleuri5.
Au début des Bouts de bois de Dieu, c’est N’Deye Touti qui incarne cette jeunesse lettrée et acculturée qui considère l’Occident comme la mesure de toute chose. Il est vrai que le cinéma n’est cette fois pas seul en cause, puisque des lectures mal dirigées ont également contribué à cette perversion.