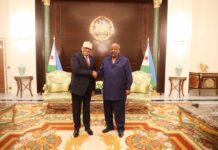Par sa situation, entre l’Afrique et l’Asie, et sa tradition bédouine d’assistance, Djibouti est à la fois une terre de passage et d’accueil. Le phénomène s’est renforcé à mesure que la petite République apparaissait comme l’unique îlot de stabilité, voire de prospérité, dans une sous-région en crise, attirant chaque année une migration multiforme en provenance du Yémen, d’Éthiopie et de Somalie.
Yéménites, Éthiopiens, Somaliens, Érythréens…
« Quelques mois seulement après son indépendance, le pays devait recueillir les réfugiés de la guerre de l’Ogaden », rappelle Houssein Hassan Darar, secrétaire exécutif de l’Office national d’assistance aux réfugiés et sinistrés (Onars) de Djibouti, créé en février 1978 à cette occasion. Depuis lors, l’organisme placé sous la tutelle du ministère de l’Intérieur n’a jamais vraiment connu de baisse d’activité, contraint de gérer, entre autres, les flux d’émigrés éthiopiens victimes des sécheresses dans les années 1980, de Somaliens en fuite depuis la chute de Siad Barré, en 1991, de Yéménites chassés par le conflit qui ravage leur pays depuis dix ans et qui viennent rejoindre les premières vagues, datant de la colonisation. « Ces dernières années, la pandémie de Covid-19 puis la guerre du Tigré ont encore jeté sur les routes de nombreux migrants », poursuit, chiffres à l’appui, Ahmed Robleh Abdilleh, le ministre djiboutien de la Santé.
La migration prend plusieurs visages à Djibouti. Depuis 1990 et l’ouverture du camp d’Ali-Adde, près de la frontière avec la Somalie, le pays accueille de nombreuses personnes ayant le statut de réfugiés : elles étaient plus de 94 000 en 1991 et sont actuellement 36 519, réparties entre trois sites, auxquels s’ajoutent celles vivant dans la capitale, qui représentent environ 20 % du contingent enregistré.
Selon les derniers chiffres communiqués par le Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR), ces migrants viennent de Somalie (45 %), d’Éthiopie (35 %), du Yémen (16 %) et d’Érythrée (3 %). Les deux premiers groupes se trouvent essentiellement dans les camps d’Ali-Adde et de Holl-Holl, situés près de la ville d’Ali-Sabieh. Les autres sont installés dans le camp de Markazi, qui a ouvert ses portes en 2015 près d’Obock, dans le nord du pays. Depuis que Djibouti a signé, en 2016, le Cadre d’action globale pour les réfugiés (CRRF), renforcé deux ans plus tard par l’adoption du Pacte mondial pour les réfugiés, ces derniers « bénéficient des services publics du pays au même titre que les Djiboutiens », explique Amina Ahmed Warsama, secrétaire générale au ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Ils peuvent également circuler librement et ont droit à un permis de travail. « Ils peuvent même demander la nationalité djiboutienne s’ils le souhaitent », ajoute Houssein Hassan Darar.
C’est davantage le cas des Yéménites, « mieux intégrés, et qui peuvent s’appuyer sur la solidarité communautaire apportée par les vagues précédentes », précise Amina Ahmed Warsama, quand les Somaliens et les Éthiopiens restent plus dépendants de l’assistance à laquelle ils ont droit. Ce qui n’empêche pas les réussites, à l’exemple de ces deux étudiants somaliens classés parmi les cinq premiers au niveau national en 2022 et qui ont bénéficié d’une bourse pour partir étudier en Turquie.
« Djibouti est l’un des rares pays à avoir intégré les migrants dans son système », insiste le ministre de la Santé, qui ne parle pas là que des réfugiés. Chaque année, Djibouti voit en effet transiter sur son sol plusieurs centaines de milliers de personnes et si certaines ne sont que de passage, d’autres s’installent dans la durée. Dans un cas comme dans l’autre, toutes bénéficient, de la même façon, de la gratuité des services de soin et de scolarisation du pays. Selon les statistiques, près de 1 000 migrants illégaux passent chaque jour la frontière, le plus souvent depuis l’Éthiopie, pour rejoindre les grandes routes migratoires qui les mèneront, pour la plupart, dans les pays du golfe Persique (distant d’une douzaine de kilomètres par le détroit de Bab-el-Mandeb), pendant qu’une petite minorité tente de rallier l’Égypte.
Risque sécuritaire ?
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime que 40 % d’entre eux demeurent un certain temps à Djibouti, gonflant les données de la « migration flottante » qui s’est établie dans le pays pour y assurer les petits boulots que les locaux ne veulent plus effectuer. Femmes de ménage ou jardiniers non déclarés par leurs employeurs, ils seraient aujourd’hui entre 190 000 et 230 000, soit près de 20 % d’une population djiboutienne d’à peine 1 million de personnes. Et ils coûtent très cher à l’État qui les accueille.
Rien que pour l’utilisation des services hospitaliers et des consommables, la facture s’élève chaque année à plus de 500 000 euros, quand Djibouti reçoit une contribution internationale dix fois moindre. Sans parler de la prise en charge des personnes décédées, une centaine par an. Si bien que beaucoup se demandent aujourd’hui si Djibouti, pays à revenu intermédiaire, dispose encore des moyens financiers nécessaires pour maintenir ses traditions d’accueil et de vivre-ensemble.
« La question se pose », reconnaît Ahmed Robleh Abdilleh, qui, comme beaucoup de ses compatriotes, attend une prise en charge «mieux partagée » avec les bailleurs de fonds et avec les pays d’où sont partis ces migrants – des États qui, à l’image de l’Éthiopie, font pour l’instant la sourde oreille. D’autant plus que les conséquences de cet afflux de population ne sont pas uniquement financières, elles sont également, et de plus en plus, sécuritaires. « Nous devons faire attention à ne pas importer les conflits extérieurs chez nous », prévient Houssein Hassan Darar. À Djibouti, la tradition a du bon, mais plus à n’importe quel prix.
Source : Jeune Afrique