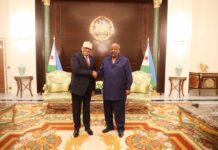La réflexion qui suit s’intéresse au cheminement de la pensée de Senghor au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Loin de l’image du colonisé aliéné que certains intellectuels ont véhiculée durant plusieurs décennies, il s’agira de mettre en évidence à quel point les réflexions critiques et esthétiques de Senghor, trop souvent négligées, ont permis la progressive affirmation d’un réalisme africain, détaché du moule esthétique et politique qui imprégnait le discours français à ce moment-là. Il s’agit donc de clarifier un parcours qui s’est achoppé aux concepts antithétiques de la raison et de l’émotion, « gros mots » devenus signes d’une polarité ontologique indéfendable.
Lors d’un colloque qui s’est tenu le 26 juin 2006 à l’Assemblée nationale française sur l’héritage de Senghor, l’historien sénégalais Mamadou Diouf fait cet aveu édifiant : « Ma génération n’aimait pas beaucoup Senghor, parce qu’il était Président, parce qu’il parlait sans cesse de la France. […]. De plus, on ne le lisait pas ; on savait ce qu’il disait en lisant ce que d’autres écrivaient sur lui, les critiques les plus virulentes. »
Dans cette même veine d’une reconnaissance tardive, le philosophe béninois Paulin Houtondji, qui avait longtemps ignoré Senghor, reconnaît dans son autobiographie intellectuelle parue en 1997, Combats pour le sens, sa contribution à l’histoire de la pensée africaine et sa grande dignité ; son compatriote Stanislas Adotevi, l’un des contempteurs les plus féroces du fondateur de la Négritude l’a réhabilité, à l’occasion des quatre-vingt-dix ans du poète3. Récemment, l’écrivain nigérian Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, auteur de la célèbre boutade contre la Négritude « le tigre ne revendique pas sa tigritude, mais il tue sa proie et la mange », a relu la poésie de Senghor à l’aune de l’actualité sud-africaine, celle du comité Vérité et Réconciliation, dont le pardon était le credo, et a décrété Senghor précurseur de cette démarche salvatrice.
Senghor, écrit Wole Soyinka, « croyait que le pardon était essentiel dans une situation où la véritable justice ne peut être rendue ». Soyinka fait allusion ici au poème de Senghor « Prière de la paix » dans lequel il pardonne à l’Europe son inhumanité à l’égard de l’Afrique. Ce poème a suscité dans les années cinquante la désapprobation unanime des intellectuels africains, à cause de ces vers : Placés dans leur contexte d’énonciation, c’est-à-dire au cœur des luttes de décolonisation dans les années 50, ces vers étaient considérés, au mieux comme une lâcheté – c’est en tous cas l’avis du philosophe camerounais Marcien Towa – au pire comme une trahison. Towa n’hésite pas à considérer que ce pardon procède d’un froid calcul : Pourtant, l’origine de ce choix du pardon est bel et bien la Seconde Guerre mondiale. Le 20 juin 1940, soit deux jours avant l’armistice, Senghor, soldat du troisième régiment de l’infanterie coloniale, est fait prisonnier à La Charité-sur-Loire.
Dès sa capture, les Allemands l’ont sorti du rang, ainsi que d’autres tirailleurs sénégalais, puis aligné le long du mur. Courageusement, un officier français entre en scène et en appelle à l’honneur des Allemands. Senghor, sauvé, est déplacé de camp en camp et c’est dans l’un d’eux, à Poitiers, au Frontslag 230, qu’il écrit Hosties noires, carnet de prison contenant « Prière de la paix », le poème de la discorde. Tout en rédigeant, Senghor lit Platon, médite sur ce qu’il nomme le « miracle grec », un métissage culturel et biologique. De cette lecture et de sa captivité date son passage de la Négritude-ghetto à la Négritude comme enracinement et ouverture.
Notre réflexion s’attardera sur le cheminement de la pensée de Senghor à cette époque, car celui-ci implique autant une capacité à pardonner, à transmettre l’expérience par la poésie, qu’à discuter de la forme même de cette transmission. Il s’agit donc de mettre au jour ce que nombre d’intellectuels contemporains de Senghor ont omis en ne voyant en lui qu’une figure figée, celle d’une forme de compromission incompatible avec la révolte à mener. La lecture rétrospective proposée veut dépasser les clivages idéologiques de ce temps pour mettre en évidence les enjeux négligés des réflexions esthétiques du poète, trop longtemps réduites à l’opposition « ontologique » de la raison et de l’émotion. De fait, notre démarche permettra de reconnaître ce que l’engagement de Senghor a réalisé : la progressive affirmation d’un réalisme africain, détaché d’un moule esthétique marqué par le discours français politisé de l’après-Seconde Guerre mondiale.
Hosties Noires, une pédagogie du pardon
Pendant la captivité, le triomphe du nazisme nous avait forcés à ouvrir les yeux. Nous avons commencé à nous apercevoir, la lecture et la réflexion aidant, que toutes les grandes civilisations, sans exception, avaient été des civilisations de métissage biologique et culturel. Je dois dire cependant que je n’ai jamais eu de haine contre les Allemands. Je me suis même mis à apprendre l’allemand, et au bout de deux ans, je parlais mieux l’allemand que l’anglais. […] Ainsi ai-je toujours fait la distinction entre le peuple allemand et le nazisme. J’ai réuni les poèmes que j’avais écrits en captivité sous le titre d’Hosties Noires. Vous n’y lirez pas un seul mot de haine.
Lu dans cette perspective, le vers tant vilipendé s’éclaire. Senghor n’a jamais caché combien durant toute sa vie il s’est évertué à concilier ses deux identités française et africaine. Mais ce qui nous interpelle ici est comment l’expérience de la guerre a façonné l’homme. La guerre, mère de toute chose disait Héraclite, a été l’expérience humaine majeure de Senghor. Cela ne surprend guère. D’autres avant lui l’ont médité. Walter Benjamin – qui n’a jamais été soldat – a mieux que quiconque montré l’impact de la Première Guerre dans la vie de toute une génération « qui était allée à l’école en tramway à chevaux », et qui, au retour des champs de bataille, était frappée de mutisme, incapable de narrer son expérience, c’est-à-dire d’assumer la transmission indispensable à la pérennité des sociétés.
Si dans l’immédiat, Senghor réussit à écrire un recueil de poèmes – une sorte d’histoire immédiate – célébrant la mémoire de ses frères d’armes et donc à assumer une forme de transmission, il montrera plus tard, lors du débat opposant Césaire à Aragon sur la question de la poésie nationale, l’incapacité du réalisme à dire le monde après la tragédie de la Seconde Guerre mondiale. Rappelons les faits pour saisir l’enjeu de son propos. Nous sommes en 1953, Aragon, auréolé de son prestige de résistant publie trois poèmes composés conformément aux règles traditionnelles de la versification française. Ils sont accompagnés d’une présentation : « D’une poésie nationale, et de quelques exemples » dans laquelle il justifie pourquoi, depuis l’Occupation, certains poètes ont eu recours aux formes traditionnelles de la versification. L’enjeu de la démarche est précis puisqu’il s’agit de mettre en cause « l’individualisme formel en poésie » pour se rallier à une nécessité de défendre des « valeurs françaises », nationales et esthétiques.
À la fin de l’année 1954, Aragon réunit en volume sous le titre Journal d’une poésie nationale l’ensemble de ses articles, suivi d’une anthologie de textes illustratifs. Ce débat lancé par Aragon serait, comme le dit Bernard Mouralis, resté circonscrit au cadre strict de l’histoire française si le poète haïtien René Depestre n’avait pas jugé bon de donner son avis.
Séjournant à l’époque au Brésil, il n’avait pas lu les articles d’Aragon parus dans les Lettres françaises, mais quand il les découvre dans Journal d’une poésie nationale, il jubile et transmet son enthousiasme au poète Charles Dobzynski dans une lettre que ce dernier publie justement dans les Lettres françaises.
Aragon, Césaire, Depestre et Senghor
Depestre écrit : « Je suis en train de résoudre, grâce à Aragon, le conflit où se débattait mon « individualisme formel » […] Je me suis théoriquement rallié aux enseignements décisifs d’Aragon et d’ici peu l’accord se fera entre la nouvelle conscience que j’ai acquise du réalisme en poésie et les moyens émotionnels par lesquels ma sensibilité est appelée à illustrer ma compréhension des problèmes soulevés et résolus dans le journal d’une poésie nationale. » Celui-ci est donc convaincu qu’il faut associer création poétique et engagement politique en passant par un usage de formes soi-disant propres à une culture, une civilisation, une nation. Interpellé par la réaction de Depestre, Aimé Césaire l’apostrophe avec le poème «Réponse à Depestre, poète haïtien. Éléments d’un art poétique» et l’y somme de pratiquer, à l’instar de leurs ancêtres fugitifs, le marronnage, mode d’insoumission, avant de conclure :
Que le poème tourne bien ou mal sur l’huile de ses gonds.
Fous-t-en Depestre fout-t-en laisse dire Aragon.
Paru dans les numéros 1-2 de la revue Présence Africaine (avril-juillet) 1955, alors que les Indépendances africaines ne sont encore qu’un fantasme, ce poème donne à la revue l’occasion d’initier un débat sur la « poésie nationale » auquel participe Senghor. À l’occasion de ces prises de position, chacun se justifie selon son expérience, sa culture et son histoire. René Depestre s’appuie sur l’histoire d’Haïti à la fois française et caribéenne en affirmant une perspective communiste sur l’art, traduite par la mise au ban de l’« individualisme formel ». Sur ce plan, il partage le même héritage que Césaire, mais celui-ci le reprend ironiquement en exploitant le registre propre aux communistes du moment:
Léopold Sedar Senghor, lui, renvoie les communistes à leur idéologie littéraire : le réalisme socialiste. Le débat initié par Aragon sur la poésie nationale n’est en réalité que le prolongement de celui engagé en Union soviétique par Fadéev sur le réalisme socialiste.
Senghor écrit : On ne demande pas aux poètes de continuer le Parnasse ni aux peintres Corot et Courbet. Comme si les dictatures de l’ère atomique n’avaient pas mené l’humanité au bord du néant, comme si la relativité et la mécanique ondulatoire n’avaient pas changé, pour nous, plus que la face, l’essence même des choses. Et c’est l’an d’angoisse 1954, c’est l’an de grâce 1955 que choisissent nos théoriciens pour nous prêcher le retour qui au sonnet, qui au réalisme. S’ils s’adressaient encore à des Aryens… Que l’épithète de « socialiste » accompagne le substantif ne change rien aux données du problème .
Non seulement il dénie au réalisme la capacité à dire le monde – et ce malgré sa prétention à l’objectivité, via le naturalisme –, mais doute même de son utilité comme genre littéraire et artistique, après 1945.
Durant la guerre, Senghor n’a pas été un intellectuel passif, scrutant l’histoire en train de se faire ; il a été un acteur, un témoin de ce que l’homme est capable de faire à l’homme. Et sur un mode mineur, il se demande comment écrire après la Seconde Guerre mondiale. Comment écrire à l’ère de la bombe atomique ? Une question que devait poser de manière plus radicale Adorno, pour qui écrire un poème après Auschwitz relevait d’un acte barbare.