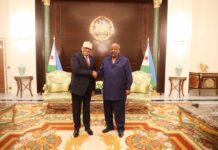Notre époque du tout numérique est propice au foisonnement d’une presse pluraliste. Encore faut-il qu’elle soit responsable et respectueuse de l’éthique journalistique ici comme partout ailleurs. L’idée s’impose d’elle-même. Elle soulève cependant les conditions d’exercice du métier de journaliste. A commencer par la délivrance de la carte de presse qui relève des prérogatives du ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications (MCPT). Neutralité de l’autorité de régulation des médias, la commission nationale de la communication (CNC), oblige.
La liberté de la presse est-elle relative sous toutes les latitudes ? La question mérite de se poser à l’heure où les réseaux sociaux grignotent chaque jour un peu plus l’espace médiatique. Elle replace la liberté de ton des journalistes au cœur des échanges virtuels houleux entre les internautes du monde entier, y compris les nôtres. Elle alimente aussi des confrontations de points de vue entre les professionnels des supports médiatiques et leurs organisations représentatives d’une part, et d’autre part les acteurs des classes politiques et les membres d’autorités de régulation des médias sur les cinq continents. Quand ils y abordent l’objectivité et la responsabilité des journaux, radios, et télévisions dans leur devoir d’information.
Justement, le sujet a nourri de vives discussions entre des représentants de notre profession et des « sages » de la commission nationale de la communication (CNC), hier au siège de cette même commission qui se veut neutre, indépendante, et garante de la pluralité de l’information.
Certains idéalistes des deux camps s’accordent à restructurer le paysage médiatique national à l’image des mass médias internationaux. Avec comme leitmotivs la promotion collective de la liberté de la presse et l’appropriation toute aussi collective des exigences de l’éthique déontologique.
Deux préalables qui constituent l’alpha et l’oméga du devoir d’information que l’on attend du quatrième pouvoir dans une démocratie, répètent-ils en chœur.
Comparaison n’est pas raison, répondent d’une même voix les pragmatiques des deux bords. Ceux-ci appellent de leurs vœux une liberté de ton des organes de presse djiboutiens quant au traitement objectif de l’information. Et ce en mettant en exergue la spécificité de notre environnement médiatique composé du quotidien de langue française, La Nation, de l’hebdomadaire de langue arabe, Al Qarn, de l’agence djiboutienne de l’information (ADI), et de l’unique chaîne audiovisuelle, la RTD, qui sont subventionnés par la puissance publique. Hormis le canard en ligne, dénommé « Human Village », dont le slogan est : l’information autrement.
Les conditions d’exercice du métier de journaliste. La parenthèse préfigure de notre devenir commun sur le court, moyen et long terme. Pour cause, notre époque du tout numérique est propice au foisonnement d’une presse pluraliste. Encore faut-il qu’elle soit responsable et respectueuse de l’éthique journalistique.
L’idée s’impose d’elle-même. Elle soulève cependant les conditions d’exercice du métier de journaliste. A commencer par la délivrance de la carte de presse qui relève des prérogatives du ministère de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications(MCPT). Neutralité de la commission nationale de la communication (CNC) oblige. « Est journaliste le professionnel des médias qui tire une source de revenus de la collecte, du traitement, et de la diffusion de l’information à caractère sportif, social, politique, économique, et culturel ».
Plus qu’une formule, il s’agit d’une norme qui justifie l’octroi de la carte de presse. Ce sésame écarte de facto l’usage usurpé de notre profession. C’est du moins la conviction affichée des responsables de la CNC. Lesquels déplorent la persistance de l’autocensure dans nos pratiques professionnelles. Avec humour et tact qui ont permis de délier les langues de leurs interlocuteurs autour de la pertinence ou non des couvertures de factuels qui vampirisent le quotidien de nos supports médiatiques, et de leurs effets contre-productifs sur la perception de l’action gouvernementale par l’opinion publique djiboutienne.
Le débat a rebondi sur les motivations existentielles de l’autocensure de mise chez les journalistes nationaux. A dire vrai, les collègues et confrères font des arrangements avec leurs consciences en perpétuant ce choix de la facilité de peur de tomber dans la précarité. Si leurs productions écrites ou commentaires audiovisuels, un tantinet critiques, portent ombrage au pouvoir politique en place.
Un projet de réforme porteur des garanties de protection juridique. Cette éventualité d’un temps révolu n’a plus lieu d’être dans notre jeune démocratie en pleine mutation. Elle ne doit plus être un prétexte d’attentisme ni un motif de désarroi chez la plupart d’entre nous tentés d’osciller entre frilosité et liberté… de ton de nos jours.
D’autant plus que le projet de réforme, porté par le ministre de la Communication, chargé des Postes et des Télécommunications, Abdi Youssouf Sougueh, offre des garanties de protection juridique au journaliste. Quand il dénonce des dysfonctionnements susceptibles de saper l’intérêt général des consommateurs locaux et de constituer un frein au processus de développement du pays. Informations vérifiables à l’appui qui ne véhiculent guère de diffamation envers une personne physique et une personnalité morale. Quelques soient les secteurs d’activités
L’avis émane de la présidente de la CNC et de son vice-président. Leur prise de position nous conforte en l’existence d’une volonté politique au sommet de l’Etat dans la promotion et la protection de la pluralité de l’information sous les cieux djiboutien.
Autant croire Ouloufa Ismaïl Abdo et Ali Mohamed Dimbio. Parce qu’à l’instar des autres sages de la CNC, ils incarnent un trait d’union ou recours administratif pour les journalistes, les pouvoirs de l’exécutif, du législatif, du judiciaire, et l’opinion nationale en ce sens. Ainsi soit-il !
MOF