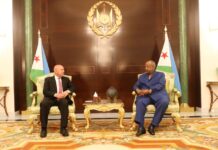La quatrième édition du Salon du Livre de Djibouti s’est imposée comme un véritable succès, célébrant avec éclat la richesse et la diversité de l’imaginaire populaire djiboutien. À travers la littérature écrite, dans toutes les langues du pays, les éditeurs, les bibliothécaires, les associations, les auteurs et autres… ont su capturer l’essence d’une culture vibrante, entre traditions orales et écritures contemporaines. Parmi ces œuvres marquantes, le recueil de nouvelles publié en mars dernier aux Éditions Discorama, à l’occasion de la Journée de l’Union de la Femme Djiboutienne, illustre cette transition fluide entre la réalité et la fiction. Au cœur de cette anthologie, l’œuvre . Les ombres de l’amour d’Abdourahman Osman Egueh, véritable pont entre la littérature orale et la littérature francophone écrite, entraîne, le lecteur/visiteur dans un voyage où émotions et récits s’entrelacent avec profondeur et sensibilité.
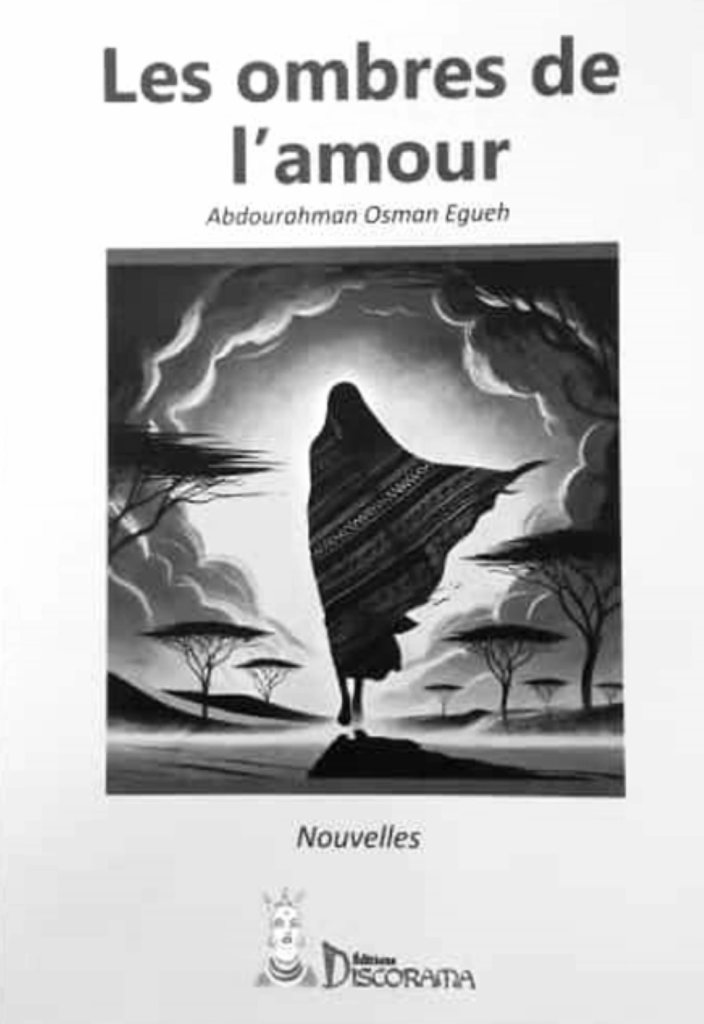
De la réalité sociale à la fiction littéraire : Quand l’amour vacille sous les ombres
Dans une société de cette corne de l’Afrique en perpétuelle mutation, la modernité et la tradition se croisent, s’entrechoquent parfois, donnant lieu à des transformations profondes dans les rapports humains. Parmi les sphères les plus touchées par ces bouleversements figure la vie conjugale. Les mariages, autrefois cimentés par des valeurs durables, se délient aujourd’hui à un rythme préoccupant. Les divorces se multiplient, les familles se recomposent, et l’amour véritable semble de plus en plus fragile. Les jeunes, pris dans les paradoxes entre héritage culturel et aspirations nouvelles, divorcent plus vite qu’ils ne s’engagent. Les unions, parfois éphémères, sont aussitôt suivies de conséquences irréversibles. Les obstacles qui surgissent ne sont guère surmontés. Pourquoi ? Les débats se multiplient, notamment sur les ondes de la radio nationale, interrogeant les causes de ces ruptures qui vacillent des deux côtés du couple.
C’est dans le contexte de cette réalité que naît le recueil Les ombres de l’amour d’Abdourahman Osman Egueh. L’auteur y donne forme littéraire à ce fléau contemporain, en ancrant son œuvre dans l’imaginaire collectif d’une société à la dérive amoureuse. Le choix du titre est révélateur : l’amour, au singulier, représente cet idéal pur et fragile, tandis que les ombres, au pluriel, désignent les forces obscures et multiples qui le menacent — déception, trahison, mensonge, incompréhension, sorcellerie, polygamie, drogue et contraintes sociales ou économiques…
Composé de dix nouvelles, tels les dix doigts de la main, le recueil forme un ensemble cohérent d’empreintes humaines narratives. Chacune de ces nouvelles est marquée par la douleur, l’échec ou le désenchantement, vécu principalement à travers des héroïnes féminines. Ce choix narratif n’est pas anodin : la femme, souvent en première ligne des bouleversements familiaux, devient la figure centrale d’un questionnement plus large sur l’amour, la fidélité, le statut marital, et les violences psychologiques ou symboliques.
Ainsi, l’écriture dans l’œuvre adopte une tonalité tragique, en parfaite résonance avec les souffrances des personnages. Elle mêle réalisme social et fiction littéraire, dans une tension permanente entre l’authenticité des situations et la force évocatrice de la narration. Fidèle à une tradition littéraire où la femme est une préoccupation majeure pour les écrivains conscients du pays, l’auteur nous livre des récits intenses, où le vécu intime se transforme en miroir d’un malaise collectif.
Des noms de personnages évocateurs :
Figures intertextuelles et réincarnations littéraires
Dans chacune des nouvelles, rien n’est laissé au hasard, et surtout pas les noms des personnages. Chacun d’eux semble porter une mémoire littéraire, culturelle ou symbolique, contribuant à donner une épaisseur psychologique aux récits.
L’auteur joue ainsi avec l’intertextualité, en convoquant aussi bien la littérature orale djiboutienne, la littérature djiboutienne d’expression française, que la littérature française classique et francophone. Ce dialogue entre traditions et références éclaire subtilement le destin tragique des protagonistes dans l’œuvre.
Prenons l’exemple de Bachir, figure connue des lecteurs de la littérature djiboutienne d’expression française. Dans « Cri de traverses » aux Editions Harmattan 1998 d’Abdi Ismaël Abdi, il est ce polygame, attaché à des idéaux anciens, mentir à sa femme et jamais dire la vérité au cœur de la Complainte de la bergère dans la nouvelle Fait-divers/information. Ici dans « les ombres de l’amour », dans la première nouvelle intitulée Les noces trompeuses, Bachir est réincarné en un narcissique manipulateur, qui courtise deux jeunes filles en même temps et devient l’artisan de leur perte. Revenu du Canada, il revient au pays natal pour épouser dans la même semaine deux jeunes fille qu’il a connu sur les réseaux sociaux. Son nom, pourtant associé à la bonne nouvelle, car Bachir signifiant l’annonciateur de bonne nouvelle, devient une ironie cruelle : il n’annonce ici que malheur et destruction.
Ses victimes, « Ayandaraan et Ismooq », au-delà des significations fortement symboliques de leur noms dans la littérature orale, elles ne sont pas de simples figures passives. Elles rappellent aussi des héroïnes tragiques de la littérature romantique du XIXe siècle, notamment Jeanne, dans Une vie (1887) de Maupassant, femme douce et rêveuse, brisée par la désillusion conjugale. Comme Jeanne, Ayandaraan et Ismooq sont piégées dans des schémas d’amour faussé, écrasées par des attentes trompeuses et des partenaires destructeurs.
De même dans, « L’étreinte de l’ombre », deuxième nouvelle du recueil Les ombres de l’Amour, la narration offre une réflexion profonde sur l’évolution des relations humaines et des perceptions sociales dans la corne de l’Afrique. A travers l’évolution psychologique de Xared, personnage principal, dont le nom évoque à la fois la prospérité et la droiture dans la littérature orale, on découvre les tensions entre amour et statut social, entre réalité et sortilège. C’est le récit d’un simple laveur de voiture qui tombe éperdument amoureux de la juge Mandek, une femme d’intelligence et de beauté remarquables, ainsi l’intrique devient le prétexte à une interrogation plus vaste : les barrières sociales et culturelles peuvent-elles être transcendées par les sentiments ? La narration interroge également les frontières entre la sorcellerie et l’amour, dressant un parallèle entre la dégradation du protagoniste et la transformation des valeurs culturelles dans l’imaginaire collectif. Ce récit subtil et poignant soulève des questions fondamentales sur le pouvoir des conventions et sur la capacité de l’amour à redéfinir les normes établies. J’en passe.
Les figures féminines mythiques :
entre malédiction et pouvoir.
Le mythe, en tant que récit transmis à travers les générations, façonne les imaginaires collectifs et reflète les croyances profondes d’une société. Dans L’ombre de l’ogresse, Anab incarne une figure mythique revisitée, celle d’une femme frappée par une malédiction pour avoir refusé un mariage polygame. Jadis, l’ogresse s’attaquait aux femmes et aux enfants, mais Anab, elle, devient la terreur des hommes de Hara, renversant ainsi les rôles traditionnels et exposant les tensions autour des normes sociales et du pouvoir féminin. Mais à quel type d’homme s’attaque-t-elle dans la nouvelle ?
Par ailleurs, dans une autre nouvelle, Le voile de Sitti, Sitti le personnage eponyme de la nouvelle rappelle le mythe d’Arawelo en portant l’image d’une femme ambitieuse, candidate à l’élection présidentielle. La peur qu’elle suscite parmi les hommes met en lumière une société encore marquée par des résistances face à la montée du pouvoir féminin. Ainsi, ces récits explorent la relation entre l’homme et la femme à travers la force du mythe, offrant une réflexion sur les dynamiques de pouvoir et les changements sociétaux.
L’écho intertextuel ne se limite donc pas à la forme : il confère aux personnages une charge émotionnelle et historique, les inscrivant dans une longue généalogie de souffrances féminines.
Par ce travail de réécriture et de réincarnation, la narration inscrit l’œuvre dans une modernité critique, qui revisite et actualise des figures anciennes.
Les nouvelles deviennent ainsi un lieu de mémoire et de dénonciation, où les mythes, les récits du passé et les douleurs contemporaines se croisent pour mieux dire la complexité de l’amour dans un monde en crise.
Les séries de coup de foudre dans l’œuvre
Cette partie de l’œuvre ouvre une réflexion profonde sur l’amour interdit et la place des sentiments dans la société, à travers le prisme de la culture zeillie. La figure de Mouliyo, première femme à avoir défié les conventions pour un amour interdit, incarne une mémoire collective où passion et tragédie se mêlent. Son histoire, réinterprétée à travers les âges, témoigne de la subtilité du rôle féminin face à l’oppression, faisant de l’écriture un véritable pont entre héritage culturel et intensité émotionnelle. Ce contraste entre les amours d’hier et d’aujourd’hui met en lumière la manière dont l’engagement sentimental a évolué, tout en conservant une part de cette essence intemporelle qui défie les normes et interroge la liberté individuelle.
Le recueil forme un tout pour une lecture qui stimule la réflexion sur les obstacles de nouvelles relations d’amour qui mènent au socle familiale : Bonne lecture
MS