
Le Journal Officiel de la République de Djibouti est bien plus qu’un recueil de textes administratifs et législatifs. Il constitue une véritable fresque historique retraçant les mutations politiques, sociales et économiques du pays. Avec la mise en ligne de son deuxième lot d’archives couvrant la période 1900-1977, Djibouti franchit une étape importante dans la préservation et la valorisation de son patrimoine documentaire. Ce projet ambitieux, initié par le Secrétariat Général du Gouvernement (SGG), témoigne d’une volonté claire de modernisation, de transparence et de démocratisation de l’accès à l’information. Il permet aux citoyens, chercheurs et passionnés d’histoire de plonger dans 125 ans d’histoires juridiques marquées par (i) la colonisation, (ii) les deux guerres mondiales, (iii) la guerre froide, (iv) les aspirations nationalistes, (v) la répression (vi) la marche vers l’indépendance, (vii) l’Indépendance, (viii) et la République.
Une méthodologie d’ouverture par étapes successives
Le processus de numérisation et de mise en ligne du Journal Officiel, un travail de longue haleine, une prouesse technologique a été réalisé en quatre phases distinctes mais interconnectées et reliées entre elles. Chaque lot représente une étape essentielle dans l’élaboration d’un corpus mémorial accessible à tous. Le premier lot, couvre la période post-indépendance de 1977 à 2024, a jeté les bases du projet en documentant les premières décennies de notre souveraineté nationale. Il offre un aperçu des défis liés à la création d’un appareil administratif moderne mais également, il montre au continu l’exercice démocratique d’une vulgarisation de notre Droit avec une parution bimensuelle du journal officiel pour compter de 1986, la séparation des mesures générales des mesures individuelles ainsi que la création d’une version arabe du journal officiel dès 2001 pour enfin la réalisation d’un journal officiel électronique.
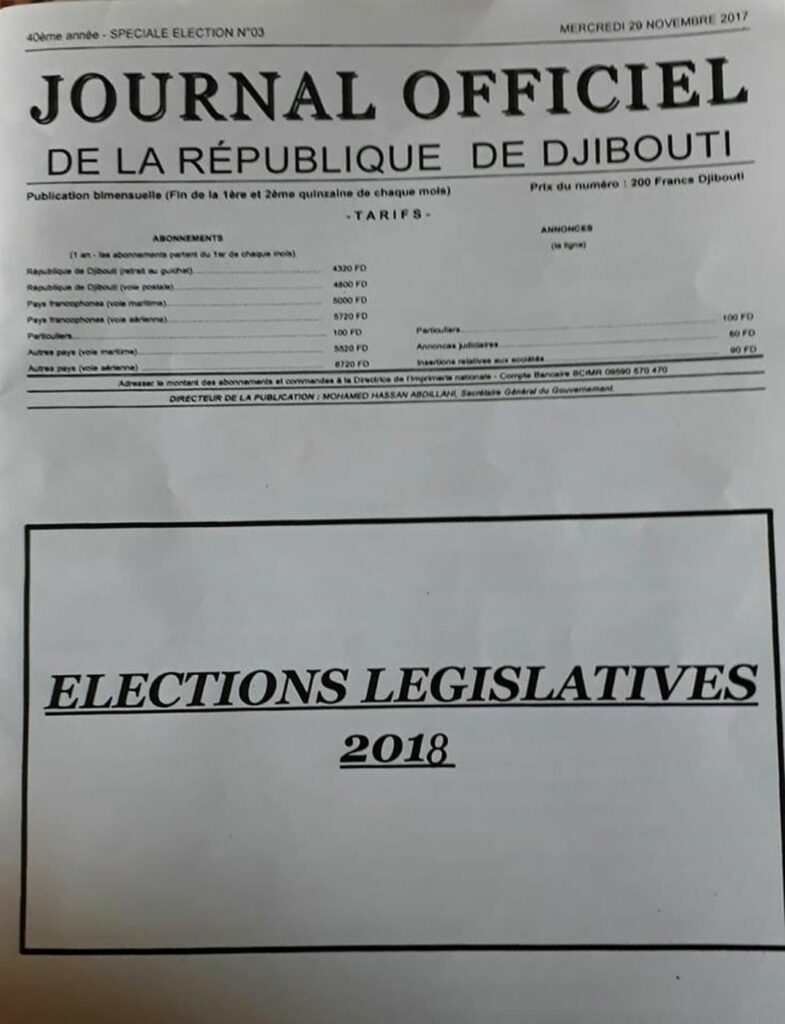
Le deuxième lot, aujourd’hui disponible, est une avancée majeure. Il couvre une période charnière, allant des premières années du XXe siècle sous administration coloniale française jusqu’à la période précédant l’indépendance en 1977. Cette tranche historique elle-même subdivisée en 4 époques séparément définies permet de mieux comprendre les structures administratives coloniales, les réformes progressives, ainsi que les luttes pour l’autonomie.
Enfin, le troisième lot, bientôt disponible, inclura les publications des mesures individuelles post indépendance, bouclant ainsi une présentation exhaustive de l’histoire documentaire de Djibouti.
Le choix de décomposer ce projet en lots distincts répondait d’abord à une logique de priorités, de sauvegarde du patrimoine et de faisabilité technique. Chacune des époques archivées nécessitait une expertise spécifique parfois en matière de restauration, de numérisation et de catalogage afin de garantir la qualité et l’intégrité des documents numériques. Cette stratégie a permis dans un laps de temps inférieur à deux années de proposer de manière progressive un accès cohérent à des ressources importantes pour la recherche et la mémoire nationale. Enfin et afin d’intégrer les technologies modernes, l’application eJO déjà accessibles aux personnes à besoin sociaux intégrera dans sa quatrième version disponible en avril 2025 des Chatbot et une IA susceptibles d’ouvrir des perspectives nouvelles dans l’accessibilité, dans l’intégration de nouvelles langues dans la codification et dans la détection des thématiques multiples.
Le Journal Officiel : Miroir des dynamiques coloniales
Les premières éditions du Journal officiel de Djibouti, publiées dès le début du XXe siècle, offrent une plongée fascinante dans l’organisation de la colonie sous l’administration française. Ces documents constituent une source précieuse pour comprendre les dynamiques politiques, sociologiques et économiques de l’époque. Ils répertorient des décrets administratifs, des lois sur le travail et des règlements économiques qui révèlent les priorités du territoire et de la métropole française : le contrôle des ressources locales, le développement des infrastructures stratégiques (notamment le chemin de fer) et la régulation des activités commerciales.
Cependant, ces archives témoignent également des inégalités systémiques inhérentes au système colonial. Les décisions politiques étaient souvent prises sans consultation des populations locales, reflétant un rapport de pouvoir asymétrique entre la métropole et ses colonies. Les textes juridiques publiés dans le Journal Officiel documentent également des tensions sociales et des résistances, qu’elles soient explicites ou implicites. Ils offrent ainsi un cadre d’analyse pour les historiens souhaitant explorer les effets du colonialisme sur les sociétés locales et leurs dynamiques internes.
Le Journal Officiel, acteur de la transition vers l’indépendance
Entre 1967 et 1977, le Journal Officiel devient le témoin direct des aspirations nationales à l’autonomie et à l’indépendance. Cette période charnière est marquée par une intensification des revendications politiques et sociales :
Déclarations des mouvements politiques, appelant à des réformes institutionnelles et à la reconnaissance des droits des populations locales.
Premières initiatives administratives, préfigurant l’émergence d’un appareil d’État autonome.
Réformes légales et économiques, destinées à poser les bases d’une économie nationale indépendante.
Ces archives permettent de retracer les étapes progressives du chemin vers l’indépendance, documentant les négociations avec l’administration française et les compromis politiques nécessaires. Elles offrent également un aperçu des défis auxquels le pays était confronté pour asseoir sa souveraineté : consolidation des institutions, réorganisation des infrastructures et développement d’une identité nationale.
L’e-Journal Officiel : un outil au service de la transparence et de l’éducation
Avec le lancement de la plateforme e-Journal Officiel (e-JO), Djibouti fait un pas décisif vers la transparence dans la gouvernance publique et dans la modernisation de l’accès à l’information publique. Ce portail numérique permet une consultation simplifiée des archives historiques et des publications récentes, rendant le Journal Officiel accessible à tous, aussi bien sur le plan national qu’international.
La mise en ligne des archives ne se limite pas à une fonction de diffusion. Elle participe à une démocratisation de l’accès à l’information légale et réglementaire. Les chercheurs, les professionnels du droit, les étudiants mais aussi les citoyens ordinaires peuvent facilement explorer des décennies de publications officielles. Cette accessibilité renforce également l’éducation civique, en sensibilisant les jeunes générations à l’importance des textes juridiques et à leur impact sur la société. Enfin, l’e-JO contribue à valoriser le patrimoine documentaire national sur la scène internationale. En rendant ces archives disponibles en ligne, Djibouti s’inscrit dans une dynamique mondiale de modernisation des services publics et de transparence administrative. Aujourd’hui, c’est plus de 1200 utilisateurs qui chaque jour se connecte et s’abreuvent de cette plate-forme et il est certain que l’ouverture de ces 125 ans d’histoires et surtout de cette phase pré coloniale augmentera de manière certaine cette connectivité.
Une initiative pour bâtir l’avenir à partir du passé
Le projet de numérisation du Journal Officiel ne se limite pas à une simple restauration technique. Il s’inscrit dans une vision globale de préservation de la mémoire collective et de renforcement de l’identité culturelle de Djibouti. Ces archives permettent d’analyser les réussites et les échecs du passé, offrant ainsi des enseignements précieux pour orienter les politiques publiques futures.
Le Secrétariat Général du Gouvernement, en coordonnant ce projet, incarne l’engagement de l’État djiboutien envers la transparence et la modernisation. En rendant accessibles des décennies de documents officiels, Djibouti affirme sa volonté de construire un avenir fondé sur une compréhension profonde des défis historiques. Cette initiative montre que la préservation de l’histoire n’est pas un simple exercice de mémoire, mais un outil essentiel pour forger une société démocratique ou les citoyens sont plus éclairés et mieux préparés à relever les défis de demain.











































