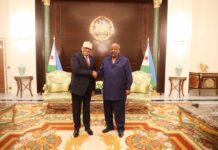La disparition de Mohamed Ibrahim Warsama « Hadrawi » constitue une grande perte pour la langue somali, à la culture et à l’identité même de ce grand peuple de la Corne de l’Afrique. « Le précieux concours que le défunt artiste a toujours apporté au rayonnement de la culture somalie», cette citation tirée du vibrant hommage du président la république de Djibouti Ismail Omar Guelleh, résume la vie et le souffle qu’il a donné à la langue somalie, qu’on peut désormais dire aussi la langue d’Hadrawi. Poète, intellectuel engagé, écrivain, philosophe Hadrawi était un génie , un homme de lettres qui nous a légué des œuvres considérées comme patrimoine commun pour tous les somalis. Hadrawi, la majorité des Djiboutiens avaient découvert cet homme de culture et ses œuvres en 1991 dans la célèbre émission « Sirta Ereyga » diffusée par la RTD.
La naissance d’un génie Mohamed Ibrahim Warsame (Hadrawi) est né dans la ville rurale de Burco dans la région de Togdheer au Somaliland en 1939. Il y passa sa petite enfance dans sa famille. À l’âge de 9 ans, il rejoint son oncle à Aden ( Yemen ). Il avait commencé sa scolarité en 1956 et obtient son bac en 1964 au lycée St. Anthony’s. Enfant surdoué, il avait sauté plusieurs classes durant son primaire et son collège.
Après avoir terminé ses études, il a travaillé comme enseignant pendant deux ans au Yémen. Puis, en 1967, il quitta la ville d’ Aden pour la Somalie. Il s’installa à Mogadiscio, où il commença son premier emploi au ministère de l’Information en 1969.
En 1971, il est embauché au ministère de l’Éducation, devenant enseignant, en même temps qu’il suivait une formation initiale au métier d’enseignant des enseignants à l’Institut (N.T.E.C.). Ensuite, il obtient un diplôme de littérature à l’université de Mogadiscio. Son goût aux vers et au théâtre est apparue avant son départ d’Aden. En 1966, il composa et présenta la pièce intitulée “Hadimo”, une pièce de théâtre qui lui avait les portes du milieu artistique. Au début des années1970, le poète Hadrawi devient un parolier à succès en signant des grands tubes de la chanson somali et composés pour les pièces de théâtre jouées par la célèbre troupe Waberi. Beledweyne, hooyo, Macalin, etc … font partis de ce répertoire devenus cultes et diffusées en boucle à Radio Mogadiscio ou Radio Hargueisa.
Mais Hadrawi avait d’autres visées que d’être un simple parolier à fabriquer des tubes de la variété Somalie.
Apôtre de la controverse comme le taquinait ses détracteurs, Hadrawi n’en avait cure et son seul souci, c’était de s’engager pour la société somalienne malmenée par les aléas de la politique du régime totalitaire de Syad Barreh.
L’amour pour le théâtre d’Hadrawi et son engagement politique avait coïncidé avec l’écriture de la langue Somalie. Après une large campagne d’alphabétisation, la société passait petit à petit de l’oralité à l’écrit. Ceci permettra à la poésie d’être étudiée, lue et distribuée dans toutes les contrées où on parlait la langue des somalis. La force des mots dans sa poésie attirait de plus en plus de public. Dans une société à tradition orale, la poésie était un vecteur culturel de premier choix.
Hadrawi, un poète engagé
Après la grande sécheresse de 1974 appelée Daba dheer (l’interminable), le peuple somali en grande partie composé des éleveurs nomades avait connu sa première exode rurale.
Des hordes de gens qui ont perdu leur cheptel venaient grossir les rangs dans les villes. Non préparée à ce genre de crise, la révolution de Siad Barre commença à battre de l’aile. C’est dans ce contexte est née la plus célèbre série de la poésie moderne somaal appelée «Manso» .
Ce nouveau forme de l’art poétique Somalie donna une conscientisation sur les enjeux d’une société traditionnelle et avide de modernité. Hadrawi et ses pairs avaient réformé la poésie qui tournait autour du thème clanique et guerres de pâturage en lançant un nouveau courant plus engagé politiquement et sociologiquement par le biais de la manso. La « Siinley » fut la première série de ce nouveau courant dont Hadrawi posa les premiers jalons avec la célèbre manso « Saharla » adressée à Abdi Qays, son binôme. Abdi Qays, Gaariye, Ibrahim Gadhley, Hassan Elmi et tant d’autres grands poètes participèrent à ce débat poétique où l’argumentation s’étalait à travers des vers dépeignant les marasmes de la Nation somaale.
Également, Hadrawi avait écrit à la même période le roman « Tawawac ».
Une pièce de théâtre intitulée « Aqoon iyo Af-garad. » lui attira les foudres du régime de Syad Barreh et il fut arrêté le 11 novembre 1973, puis incarcéré à Qansax Dheere (région de Bay ) jusqu’au 9 avril 1978. Ainsi, une chape de plomb tomba sur le milieu des artistes et une vague d’oppression et de répression était devenue le lot quotidien des poètes engagés. En 1982, il avait été nommé directeur du département des arts à l’Académie des arts et des lettres ; Parallèlement, il était l’un des chefs de file de la célèbre série poétique “Deelley” qui connaissait un succès auprès du public depuis le début des années 1980. Le 1er mai 1982, Hadrawi rejoignit le Mouvement national somalien, appelé SNM et s’engagea dans la lutte politique, littéraire, patriotique et pour la liberté du peuple.
Hadrawi, l’homme du consensus
À partir des années 90, Hadrawi continua son engagement et sa lutte en militant pour la paix et la justice dans une somalie dévasté par la guerre civile. La réconciliation, le dialogue, la grandeur de l’esprit, autant de combats que le poète le plus respecté des somalis à l’unanimité qu’il a mené jusqu’à son dernier souffle pour remettre sur les rails une nation en mal de reconstruction.
Durant ses différents séjours à Djibouti, Hadrawi avait participé à la célèbre émission « Sirta erayga » de la RTD, une émission qui avait accueilli tous les grands poètes contemporains d’expression somali.
Une émission dans laquelle les Djiboutiens découvriront Hadrawi, en bon pédagogue permis de rapprocher les téléspectateurs. Dans sa posture de magister, il trouvait le ton pour mettre la poésie à la portée du public toutes âges confondues.
Hadrawi avait également participé à bon nombre de forum et symposium à caractère culturel durant ses différents séjours à Djibouti, sa seconde patrie comme il aimait répéter à ses interlocuteurs. Enfin, le décès de Mohamed Ibrahim Warsama va laisser un grand vide dans la culture. Un grand esprit, une personnalité unique en son genre que le peuple somali ne trouvera guère de si tôt dans ses rangs.
Hadrawi, de Djibouti à Mogadiscio en passant par Jigjiga ou Kysmayo, était devenu le trait d’union d’une nation somali en déliquescence.
Moustapha Gaucher