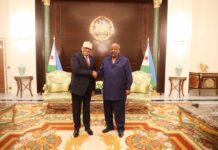L’essentiel du vibrant discours du chef de l’Etat djiboutien prononcé hier, au 2e jour des travaux de la 33e session ordinaire de l’Assemblée de l’Union Africaine à Addis Abeba.
« A juste titre, notre assemblée s’est engagée en 2013 «à ne pas léguer le fardeau du conflit et de la destruction à la prochaine génération d’Africains et nous nous sommes engagés à mettre fin à toutes les guerres d’ici 2020». Nous sommes aujourd’hui arrivés à la date fatidique. Certes, nous sommes bien loin de notre objectif, mais cela ne veut pas dire non plus que nous avons dormi sur nos lauriers, car depuis les premiers balbutiements de notre organisation nous avions mis en place un centre de gestion de conflits qui a été continuellement réformé afin de répondre aux besoins de notre continent et ce jusqu’à son format actuel qui est l’APSA (architecture africaine de paix et de sécurité).
Une bonne gouvernance et une politique inclusive
Alors que faire pour empêcher cette persistance ou la résurgence de conflits dans certaines parties de notre continent ? A mon sens, l’édification de sociétés résilientes est essentielle pour faire taire les armes à feu en premier lieu. Cela implique des institutions fortes qui répondent aux besoins des citoyens, une bonne gouvernance et une politique inclusive. Ces dernières années, le continent a fait de grands progrès non seulement dans l’approfondissement de la démocratie et des institutions démocratiques, notamment grâce à la mise en œuvre de l’architecture de gouvernance africaine telle le MAEP, mais également au niveau du développement des connaissances, des compétences et de l’expertise dans la prévention, la gestion et la résolution des conflits en Afrique.
Accélérer le développement en éliminant la pauvreté et les inégalités
En second lieu, nous devons rester forts et vigilants, à la fois dans nos capacités de dissuasion, de prévention et de réaction. Il nous faut rester à l’écoute de la population en encourageant la création de plates-formes facilitant le dialogue et leur participation aux processus politiques et économiques afin de promouvoir l’équité. Il nous faut, également, accélérer le développement en éliminant la pauvreté et les inégalités, s’attaquant ainsi aux profonds facteurs structurels des conflits africains. Il nous faut, en outre, renforcer les capacités locales et nationales de prévention et de gestion des conflits afin que les femmes, les jeunes, les chefs de gouvernement, les chefs religieux et autres puissent tous être formés afin de gérer les conflits à leur source, et empêcher l’escalade ainsi de ces conflits.
Evaluer les situations pouvant conduire à la violence et prévenir l’escalade
Il nous faut, enfin, les inciter à participer aux infrastructures de paix et à d’autres mécanismes, tels que les centres nationaux de coordination des interventions d’alerte précoce. Les conséquences des changements climatiques, entre autres, menaçant la sécurité alimentaire des populations et entraînant ainsi des déplacements de populations, apportent leur lot de conflits intercommunautaires aux frontières. A titre d’exemple, dans les années 90, la région de l’IGAD connaissait une trentaine de conflits intercommunautaires, une prolifération d’armes légères, beaucoup de conflits pastoraux transfrontaliers.
C’est dans cet esprit que nous avons mis en place en 2002 dans notre région le mécanisme CEWARN qui réunissait Djibouti, Éthiopie, Kenya, Somalie, Ouganda, Soudan et Érythrée. Le Sud Soudan a rejoint le CEWARN dès son indépendance. La mission principale du CEWARN était d’évaluer les situations pouvant potentiellement conduire à la violence ou à des conflits et prévenir l’escalade car ces disputes s’expriment aujourd’hui en armes automatiques, sans oublier les groupes terroristes en prédation, pour qui ces failles représentent des opportunités inespérées et à travers lesquelles ils prospèrent.
La coopération entre Etats, un impératif d’intérêt commun
En dépit des progrès réalisés dans la pacification et la stabilisation du continent, les défis restent importants car de nombreux pays frères restent “prisonniers du cercle vicieux de conflits violents en raison de la criminalité transnationale, du terrorisme et de la prolifération des armes légères et de petit calibre. Le terrorisme et l’extrémisme violent constituent une plaie dans notre continent, une plaie qui laisse dans son sillage dévastation, désespoir et tragédie. Nous tous y sommes exposés et chacun d’entre nous constitue une cible potentielle. Face à ces menaces, la coopération entre Etats ne se pose plus comme un devoir de solidarité, mais bien comme un impératif d’intérêt commun car nos vies en dépendent. Djibouti abrite, à cet égard, le centre régional sur l’extrémisme violent (CVE) qui est un centre d’excellence dédié à la formation, au dialogue et à la recherche. Une multiplication de ce type de centre, une coopération étroite entre les pays, un partage d’informations permanent, l’éveil des consciences par des sensibilisations et la mise en place de remparts contre la manipulation des consciences, surtout auprès des jeunes, s’imposent.
Nous sommes capables de faire de la paix une réalité
Une Afrique sans conflit est bien entendu la responsabilité première des Africains. Nous sommes capables de faire de la paix une réalité viable et durable à travers notre continent. Mais comme l’adage le dit chez nous « Une main ne se lave pas toute seule». Faire taire les armes à feu pour de bon nécessite la participation de tous. Nous l’avons vu, le partenariat de l’Union africaine et des Nations Unies a déjà porté ses fruits dans différents pays de notre continent.
C’est seulement unis et solidaires et parlant d’une seule et même voix, que nous allons pouvoir atteindre nos objectifs car le défi est énorme ».