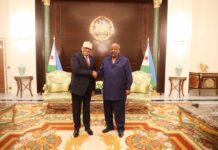Deux jours durant, Djibouti a abrité les travaux d’un Colloque régional marquant le cinquantenaire de l’alphabet afar. Loin de constituer une simple commémoration, cet événement de portée historique était une invitation à réfléchir sur la richesse de nos langues nationales et sur leur place dans notre société.
Djiboutiens ou issus des pays voisins, linguistes, historiens, écrivains et acteurs de la société civile se sont ainsi penché sur l’état de cette riche langue afar parlée dans trois des quatre pays de la Corne de l’Afrique, sans oublier ses inombrables locuteurs dans la diaspora. Comment assurer la pérennité de cette langue face aux mutations sociétales et technologiques ? Comment la rendre plus accessible aux jeunes générations ? Ces questions ont été au cœur des discussions.
En fait, cet anniversaire nous rappelle une vérité essentielle : une langue qui vit est une langue parlée, enseignée et partagée. Et la sauvegarde d’un patrimoine linguistique exige, avant tout, un effort collectif et soutenu.
A l’ère d’une mondialisation effrénée, la tentation est grande de privilégier les langues internationales, considérées comme des vecteurs de modernité et de progrès. Pourtant, nos langues nationales, l’afar et le somali, portent en elles l’âme de notre nation. Elles racontent notre histoire, transmettent nos valeurs et forment le socle de notre identité collective. Ignorer leur importance reviendrait à nier une partie de nous-mêmes.
Malheureusement, force est de constater que ces langues occupent encore une place marginale dans notre système éducatif. Si le français et l’arabe, langues officielles, jouent un rôle essentiel dans l’ouverture au monde et l’accès au savoir, cela ne doit pas se faire au détriment des langues qui sont le reflet direct de nos réalités culturelles. Intégrer l’enseignement de l’afar et du somali à l’école, c’est offrir à chaque enfant djiboutien la possibilité de se reconnecter avec ses racines tout en affirmant son appartenance à une communauté nationale diverse et unie.
Loin d’être un luxe ou un retour en arrière, cette initiative est une nécessité. Plusieurs pays dans le monde ont montré qu’un enseignement bilingue ou multilingue renforçait les compétences linguistiques générales et favorisait l’apprentissage des langues étrangères. En promouvant l’afar et le somali dans notre éducation, nous élevons nos langues au rang de patrimoine vivant et contribuons à leur perpétuation.
Il appartient à nous tous — dirigeants, enseignants, parents et citoyens — de plaider pour une véritable politique linguistique nationale qui valorise nos langues. Car en renforçant l’usage et l’apprentissage de l’afar et du somali, nous écrivons une page essentielle de notre histoire. Une page où chaque mot, chaque lettre, chaque élément de notre patrimoine linguistique trouve sa juste place dans l’œuvre collective de la construction nationale.
Il serait regrettable de laisser cette opportunité s’éclipser dans les discours sans lendemains. Mettons-les au cœur de notre projet de société et faisons en sorte que, dans cinquante ans, nos enfants puissent célébrer non seulement la survie, mais l’épanouissement de nos langues nationales.