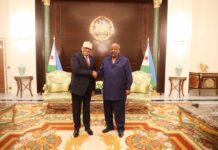« En dépit des progrès réalisés dans la pacification et la stabilisation du continent, les défis auxquels l’Afrique fait face restent importants. C’est dans cette optique que notre assemblée s’est engagée dans l’initiative -faire taire les armes-.
En effet, une multitude de menaces qu’elles soient nouvelles ou traditionnelles, qu’il s’agisse du terrorisme ou d’autres formes de criminalité transfrontalière, notamment le trafic d’armes et d’êtres humains, transcendent désormais nos frontières et anéantissent nos progrès.
Par ailleurs, cet ennemi invisible qu’est la pandémie de la covid-19 qui a impacté le monde entier, a indubitablement affecté notre action visant à faire durablement taire les armes. Etant donné l’urgence et l’ampleur de cette crise, notre Union a en effet, été obligé de réaffecter, les ressources préalablement mobilisées pour une Afrique sans conflits, vers la lutte contre la pandémie. De même, un certain nombre d’activités prévues ont, malheureusement, du être soit reportées, soit annulées.
Les conséquences du changement climatique menacent la sécurité alimentaire des populations, accentuent la pauvreté et entraînent des déplacements de populations apportant ainsi leur lot de conflits intercommunautaires aux frontières.
Comment donc donner corps à cette vision d’un continent prospère débarrassé des fléaux de la guerre et de la pauvreté ?
Par la coopération, la solidarité, la résilience, la concertation et la prévention.
Face à ces défis qui fragilisent encore plus nos stratégies de développement économique et social, notre Union a d’ores et déjà mis en place un mécanisme adéquat. En effet, depuis les premiers balbutiements de notre organisation, nous avons créé un centre de gestion de conflits qui a été continuellement réformé afin de répondre aux besoins de notre continent et ce jusqu’à son format actuel qui est l’APSA (architecture africaine de paix et de sécurité).
A titre d’exemple, dans les années 90, la région de l’IGAD connaissait une trentaine de conflits intercommunautaires, une prolifération d’armes légères, beaucoup de conflits pastoraux transfrontaliers. C’est dans cet esprit que nous avons mis en place en 2002 le mécanisme CEWARN qui réunissait les pays de la région et dont la principale mission était d’évaluer les situations pouvant potentiellement conduire à des conflits et prévenir ainsi l’escalade car ces disputes s’expriment aujourd’hui en armes automatiques.
La situation qui prévaut dans la corne de l’Afrique et dans la région sahelo-saharienne nous préoccupe fortement. Nous devons veiller à ce que nos Etats soient forts et résilients.
Dès lors, cette réunion se doit de proposer une feuille de route, claire et globale afin de répondre au défi de l’instabilité multidimensionnelle avec une stratégie globale pour notre continent incluant notamment un ajustement de l’opérationnalisation de la Force africaine en attente aux défis sécuritaires transrégionaux.
Le Sahara Occidental reste également marqué par de vives tensions. La rupture du cessez le feu après deux décennies est regrettable dans une région déjà instable.
Fidèle à sa politique traditionnelle, la République de Djibouti appelle les acteurs concernés à privilégier le dialogue dans le respect du droit international, notamment les résolutions pertinentes du Conseil de Sécurité des Nations Unies.
A notre niveau, il est indispensable que nos demeurions dans la lignée de la décision 693 de Notre Conférence, adoptée à Nouakchott en 2018, qui a posé les bases d’un consensus constructif au sein de notre organisation notamment le soutien aux efforts des Nations Unies ainsi que la création d’une Troïka de l’Union. En outre, si nous voulons que la voix de l’Afrique compte dans la résolution de cette question, il est impératif que nous privilégiions le consensus au sein de notre organisation et évitions les divisions observées dans le passé.
Enfin, la République de Djibouti joint sa voix aux appels à la nomination d’un envoyé spécial des Nations Unies sur cette question ».