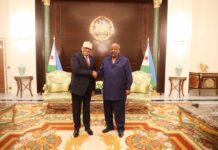Elles trônent au coin des rues, leur sac à main rempli d’euros, de birrs éthiopiens, de roupies indiennes : à Djibouti, les changeuses de monnaie sont partout, remplissant un rôle clé dans une économie majoritairement informelle.
Installées sur une chaise en plastique, les jambes calées sur un petit marchepied de bois, des dizaines de “sarifley” (changeuses d’argent, en somali) attendent, seules ou par petits groupes, le passage des clients, qui les préfèrent aux classiques bureaux de change.
“J’en ai de toutes sortes. Il y a l’euro, la livre sterling, la livre turque, le dollar, la roupie indienne, et tout autre type”, énumère en somali Medina, qui comme beaucoup de ces femmes préfère ne donner que son prénom.
“Ça ne doit pas faire moins d’un million de francs” djiboutiens (près de 4.700 euros), estime en rehaussant ses larges lunettes fumées cette ancienne “artiste” ayant gardé des airs de diva.
Sur la place Mahamoud Harbi, surplombée d’une élégante mosquée, Medina et trois de ses amies officient en pleine chaleur, au milieu des voitures, des klaxons, des échoppes et des passants qui fourmillent dans ce poumon de Djibouti-ville.
Un jeune Yéménite, en longue robe et turban blancs, s’approche pour changer des riyals saoudiens. Medina parlemente, pianote sur son téléphone puis extirpe d’un des nombreux compartiments de son sac en bandoulière un paquet de billets froissés, qu’elle lui tend.
Proximité. “On prend de l’argent saoudien avec nous, parce que notre monnaie, avec la guerre (au Yémen), elle change tout le temps”, explique-t-il en anglais avant de s’évanouir dans la nature à l’approche d’une voiture de police.
Ancré aux confins de l’Arabie et de l’Afrique, Djibouti est un carrefour millénaire où se croisent réfugiés de la guerre au Yémen, militaires étrangers ou encore chauffeurs de camions venus de l’Ethiopie voisine, qui a fait de ce petit pays son principal port. “On traite avec les hommes d’affaires djiboutiens qui vont à l’étranger pour leurs activités, on collabore avec les étrangers et les touristes”, liste Noura Hassan, assise plus loin.
Lorsque son mari est décédé, il y a 10 ans, cette mère de trois enfants portant un voile bleu et une abaya noire a commencé avec les économies du ménage, en francs djiboutiens. Depuis, les devises se sont diversifiées et Noura Hassan récupère chaque jour à la banque un imprimé lui donnant le taux de change des grandes monnaies. “C’est un bon travail et j’en suis fière”, assure-t-elle.
A PK12, un quartier populaire où vivent de nombreux Ethiopiens, Ahmed saute de son tuk-tuk pour changer quelques birrs.
“La différence est de 10 ou 20 francs, ce n’est pas beaucoup”, dit-il à propos du tarif proposé par les bureaux de change. Ces derniers sont loin, ajoute-t-il, quand “ces femmes-là sont à proximité”.
“Sans elles, je dirais que le commerce à PK12 ne pourrait pas se faire”, renchérit Faiza, 25 ans, une vendeuse de khat – une plante euphorisante consommée quotidiennement à Djibouti.
“Elles font en sorte de nourrir leur famille (…) On s’entraide comme ça”.
“Les yeux fermés”. Comme le note l’économiste Abdulkader Hussein Mohamed, “l’économie informelle a un poids considérable en terme de création d’emplois”, totalisant les deux tiers de l’activité.
Et “73% des actifs occupés dans le secteur informel sont des femmes”, ajoute ce chercheur du Centre d’Etudes et de Recherche de Djibouti. En plus d’offrir un emploi accessible dans un pays où les femmes sont moins alphabétisées que les hommes, le change est un travail sans danger, assurent-elles : à Djibouti, qui compte moins d’un million d’habitants, même la capitale est un village, et la police n’est jamais loin.
Les vols, “on n’en a jamais vu”. “Celui qui vole de l’argent, il ne vient pas à nous, il a peur”, balaye en français Zahra, installée dans le centre-ville. Elle ne craint pas plus les faux billets.
“Une copie ? s’écrie-t-elle. Si moi je dors et que tu me donnes un faux billet, je le sais (…) Copie, je sais. Original, je sais. C’est mon travail, n’est ce pas?”
AFP