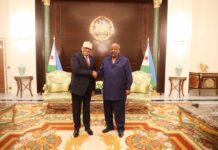Le ministère de l’Éducation Nationale et de la Formation professionnelle (MENFOP) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) ont organisé un atelier international sur les curricula et les manuels de français et en français du dimanche 3 au mercredi 6 novembre 2024, à l’Ayla Hôtel de Djibouti.

Inauguré par le ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, en présence de ses collègues Dr Nabil Mohamed Ahmed et Mme Mouna Osman Aden, respectivement ministres de l’enseignement supérieur et de la recherche, et ministre de la Femme et de la Famille, la rencontre a vu la participation de la directrice du Centre Régional Francophone pour l’Afrique, (CREFA), Dr Rennie YOTOVA et des hauts cadres du MENFOP.
Cet atelier fut un moment intense d’échanges et de réflexion entre les experts venus du Rwanda, d’Égypte, du Qatar, des Seychelles, du Liban, du Burundi, du Ghana et les experts nationaux en charge de l’édition des curricula et des supports didactiques et pédagogiques. Il intervenait à un moment où, d’une part, le MENFOP, fort de son expérience dans le domaine, peut enfin exporter son modèle, le savoir-faire de ses experts, contribuer à l’enrichissement des curricula et des supports des pays amis et ou pays demandeurs. Et l’OIF a entrepris un vaste chantier où chaque pays est invité à « définir par lui-même son positionnement et à identifier les actions à entreprendre » pour que la coopération et la collaboration avec l’Organisation et les autres pays francophones soient revivifiées en vue de créer ou recréer un espace francophone où la langue française est une chance et un outil au service du développement durable.
L’atelier a été facilité par un éminent expert, en l’occurrence, M. Bruno Maurer, Professeur Ordinaire à l’Université de Lausanne et éminent spécialiste de la situation linguistique de notre pays. Le Professeur Maurer est un ami personnel du MENFOP et de Djibouti, où il a enseigné au Centre de Formation du Personnel de l’Éducation Nationale (CFPEN, actuel CFEEF), formant d’inombrables professeurs en français langue seconde. De 2010 à 2016, il a dirigé les travaux de la réforme de l’enseignement du français au niveau secondaire. En somme, l’homme jouit d’une expertise avérée en sociolinguistique des contacts de langues et en didactique des langues étrangères et du français langue seconde. Il était secondé par le Docteur Samatar Abdallah, chercheur djiboutien en didactique des langues au CRIPEN.
Il a fait à profit de l’atelier fut l’occasion pour mettre l’accent sur les objectifs et les concepts fondamentaux inhérents au curricula et aux manuels scolaires, ainsi qu’au statut des langues dans les diverses situations linguistiques des pays participants.Des situations les unes plus intéressantes et fascinantes que les autres, qui ont piqué la curiosité des experts dépêchés par les pays participants et des experts nationaux sous la direction du Professeur Bruno Maurer.
Des présentations qui ont alimenté des analyses approfondies et des échanges exaltants sur la diversité des situations, les politiques linguistiques qui en découlent, les pratiques langagières riches et diverses parfois dans un espace très réduit et les causes profondes mais aussi les enjeux liés à cette foisonnante richesse.Tant de situations linguistiques complexesqui confèrent à la langue françaiseun statut tantôt de langue étrangère enseignée comme discipline, tantôt de langue seconde qui a une place non négligeable dans la vie de tous les jours ou dans l’administration. Parfois, elle est langue officielle mais aussi paradoxalement que cela puisse paraître, la population utilise les langues nationales dans toutes les sphères de la vie, même dans l’administration. Ailleurs, elle a une place privilégiée sans qu’elle n’influence les enseignements. D’autres parlent couramment le français alors qu’il n’a pas de statut privilégié. Ces échanges passionnants ont permis de découvrir combien ces situations linguistiques et le statut de la langue française sont tributaires de l’histoire politique de ces pays et de ses contacts avec l’extérieur.
Ensuite, les participants ont mené des analyses sur les curricula et les manuels durant deux jours. Les grilles d’analyses comparative des curricula et des supports pédagogiques sesont particulièrement intéressées aux cadres d’orientation curriculaires des pays présents, mais aussi aux politiques du livre, et au dispositif d’élaboration et de diffusion des productions (les profils des concepteurs, des valideurs, la durée de l’élaboration, l’évaluation des produits finaux etc.).Une étape clé du travail qui fut encore plus enrichissante en ce qu’elle a permis aux participants d’apprécier les efforts consentis par l’Institution, le travail abattu et la qualité des productions.
Aussi, les participants, sous la direction du Professeur Maurer, ont été sensibilisés à la nécessité de s’armer contre les «concepts voyageurs », qui, parfois, peuvent induire en erreur les acteurs des réformes ; les contextes étant plus complexes que ce que renferment ces concepts. Il est à noter que la réflexion ne s’est pas limitée à l’enseignement des langues, les disciplines non linguistiques (DNL) ont aussi fait l’objet d’une analyse rigoureuse.Les échanges et les pistes d’intervention pour la suite ont été partagés dans un espace dédié au partage d’expériences et ont été présenté en fin d’atelier en présence des officiels. Les premiers contacts entre délégués ont été établis et la République de Djibouti compte tirer son épingle du jeu en mettant à la disposition des pays qui manifestent leur intérêt pour la longue et riche expérience du CRIPEN, cheville ouvrière du MENFOP depuis 35 ans.
Mohamed Moussa Yabeh
Conseiller Technique au MENFOP et Secrétaire général de la commission nationale de l’UNESCO
La Parole à… Moustapha Mohamed Mahamoud Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle

« Faire de DJIBOUTI un carrefour d’échanges pour le Renforcement de l’enseignement-apprentissage du Français »
« La République de Djibouti se positionne comme un carrefour d’échanges et de réflexions autour de l’éducation francophone. L’atelier international sur les curricula et les manuels scolaires, qui s’est déroulé à l’Aya Grand Hôtel de Djibouti, a réuni des experts de huit pays, représentant des cultures francophones, arabophones et anglophones. Cet événement, que nous avons coorganisé avec l’OIF, revêtait une importance capitale pour l’avenir de l’enseignement de la langue française, tant comme discipline linguistique que comme matière interdisciplinaire.
En parallèle à cet atelier, un salon des manuels scolaires a mis en lumière le développement d’une édition scolaire nationale et les innovations pédagogiques de Djibouti et des pays participants. Les productions djiboutiennes ainsi que celles des pays francophones invités s’y sont distinguées, avec une exposition de supports didactiques et pédagogiques, ainsi que des matériels d’accompagnement élaborés pour le préscolaire, l’enseignement fondamental, le secondaire, et une édition numérique. Ces initiatives témoignaient du savoir-faire éditorial de Djibouti et des pays participants.Cet atelier s’inscrivait dans la stratégie 2023-2030 de l’OIF, qui vise à renforcer l’usage du français. Nous avons souligné l’importance de cette initiative pour établir un réseau solide entre les pays de la Francophonie. Ce réseau favorise le partage d’expériences et d’outils pédagogiques, indispensables pour faire évoluer l’enseignement et l’apprentissage du français dans les écoles. Il cherchait à permettre aux élèves à développer leurs compétences communicationnelles tout en respectant le contexte socioculturel intrinsèque à chaque pays. En conjuguant les efforts, nous avons voulu édifier ensemble une éducation qui célèbre la diversité linguistique et culturelle, tout en garantissant une formation de qualité en français. L’ambition de cet atelier ne se limitait pas à l’échange de bonnes pratiques. Il visait à établir l’enseignement du français comme une passerelle éducative et culturelle entre les nations. Pour Djibouti, unique pays francophone de la région, ce défi est crucial : il s’agit de valoriser la langue française tout en l’adaptant aux exigences pédagogiques et technologiques contemporaines. Dans un contexte où l’inclusion et la reconnaissance des spécificités linguistiques sont plus que jamais nécessaires, ce défi est d’une importance capitale.Pour finir, cet atelier représentait une occasion unique de bâtir une communauté éducative forte et solidaire. Nous avons appelé donc tous les pays francophones à mutualiser leurs ressources, à s’inspirer des pratiques exemplaires et à construire ensemble un avenir où la langue française, bien plus qu’un simple outil de communication, devienne un pilier de notre vision partagée de l’éducation.Djibouti, en tant que porte-étendard de la langue française en Afrique de l’Est, lance un appel à ses partenaires : unissons-nous pour faire du français une langue porteuse d’un message inclusif et universel. Aujourd’hui, le français est bien plus qu’une langue; il incarne un projet éducatif commun qui peut et doit répondre aux aspirations des jeunes générations».