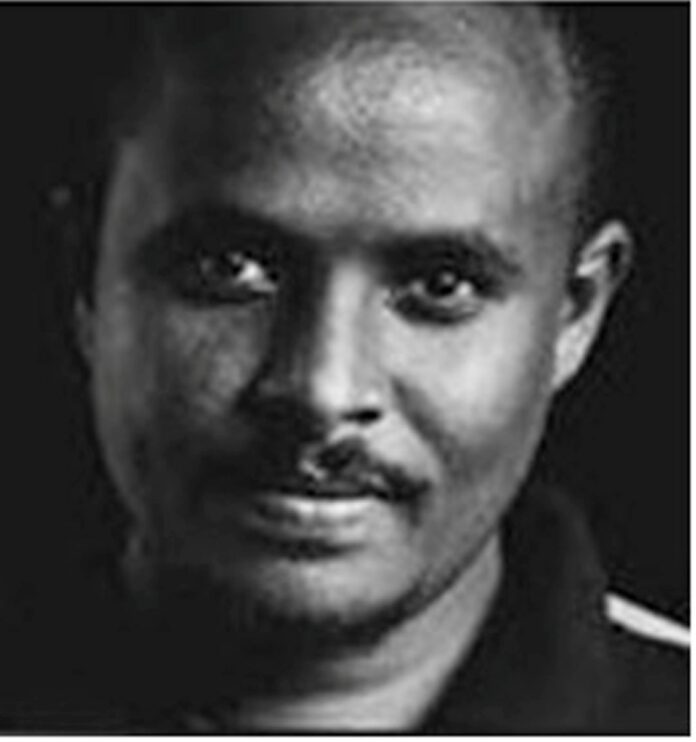
Il fut l’un de ces écrivains rares dont la parole, sans jamais chercher le vacarme, s’inscrivait dans les silences lourds d’une société en proie à ses contradictions. Abdi Ismaël Abdi, auteur, universitaire, dramaturge et penseur, a incarné pour Djibouti une conscience littéraire en éveil, subtile, engagée et profondément ancrée dans la complexité de son époque. Né en 1968 à Dire Dawa , il a très tôt été sensible aux déchirements identitaires, aux lignes de fracture entre tradition et modernité, aux traumatismes d’une société postcoloniale en quête de repères. Après des études en France qui l’ont conduit à soutenir en 2003, à l’Université de Perpignan, une thèse de doctorat sur Le fantastique dans la littérature négro-africaine, il rentre à Djibouti et intègre l’Université où il enseigne la littérature et la philosophie, tout en s’investissant dans l’écriture, la mise en scène théâtrale, et l’encadrement de jeunes auteurs.
Mais au-delà de l’enseignant érudit et du metteur en scène engagé, c’est d’abord l’écrivain qui s’impose. Un écrivain de l’intime et du social, de la mémoire blessée et de l’humanité en tension. Dès L’enfance éclatée (1997), il donne le ton. Dans ce recueil de nouvelles, publié par le Centre Culturel Français de Djibouti, il révèle une société où les enfants – figures symboliques et réelles – deviennent les premières victimes d’un monde déchiré.
Cette enfance qui éclate, c’est celle d’un pays fragmenté, d’un avenir incertain, d’une innocence qu’aucune institution ne parvient à protéger. La langue y est poétique, précise, douloureusement belle. Elle annonce déjà la singularité d’une voix littéraire qui refuse le confort des clichés.
Son deuxième recueil, Cris de traverses (1998), confirme et approfondit cette veine lucide. À travers sept récits âpres, Abdi Ismaël Abdi dresse une cartographie sensible des marges sociales : femmes humiliées, mères abandonnées, jeunes errants aux prises avec l’absurde, la violence ou le silence. L’écriture se fait ici à la fois scalpel et baume : elle dissèque, mais elle console aussi. C’est une littérature de l’écoute, de l’attention aux voix oubliées, aux cris qui se perdent dans les ruelles poussiéreuses de villes anonymes.
Le théâtre fut pour lui une autre scène – au sens propre comme au sens figuré – pour dire l’indicible, pour confronter les masques sociaux. La Lune de nos faces cachées (2002), recueil de deux pièces puissantes, dont Tica-Tica, primée au concours Lire en fête, donne à voir des personnages en errance, en quête de dignité, en lutte contre des forces sociales et psychologiques plus grandes qu’eux. Mais l’auteur ne tombe jamais dans la caricature.
Son théâtre est subtil, nuancé, souvent ironique, parfois teinté de fantastique. Il y a chez lui un goût pour les zones troubles, pour les situations où la vérité ne s’impose pas mais se cherche, douloureusement. D’autres pièces, parfois restées inédites comme Yeli Yelo ou le retour du faiseur de miracles, Kasse la tête ou Poussières de Nubie, prolongent cette exploration théâtrale de l’humain en crise, dans un décor africain à la fois réaliste et onirique. Mises en scène à Djibouti, ces œuvres marquent l’éveil d’un théâtre national, au croisement de l’oralité traditionnelle et des formes modernes.
Son dernier ouvrage, publié de façon posthume en 2009, Vents et semelles de sang, reprend le motif du recueil de nouvelles. Sept textes se déroulant dans la ville imaginaire de Yama-Yama, où les destins s’entrelacent, les vies se cognent, les rêves s’effilochent. Ici, le style s’est encore épuré, mais il gagne en universalité. Moins lyrique, plus méditatif, plus sombre aussi. C’est un testament littéraire, un condensé de son art, où chaque mot semble pesé, où la violence du monde n’est jamais gratuite, mais questionnée jusqu’au vertige.
La disparition d’Abdi Ismaël Abdi, en mars 2007 à Paris, à l’hôpital du Val-de-Grâce, fut une perte immense pour les lettres djiboutiennes. Trop tôt disparu, il laissait une œuvre à la fois modeste par son volume mais immense par sa portée. Car il n’écrivait pas pour séduire ou divertir. Il écrivait pour comprendre, pour réveiller, pour transmettre. Son œuvre, entièrement francophone, est aussi une tentative de bâtir une langue littéraire propre à Djibouti, sans renier les racines orales ni les influences extérieures. Il est de ceux qui ont su faire dialoguer le conteur ancestral et l’intellectuel moderne, le griot et le philosophe.
Aujourd’hui encore, ses textes résonnent avec une acuité particulière. Alors que Djibouti cherche à affirmer davantage sa place dans l’espace littéraire francophone, alors que les jeunes générations redécouvrent peu à peu les trésors de leur propre patrimoine culturel, Abdi Ismaël Abdi demeure une figure tutélaire, un repère, un phare discret. Son exigence de vérité, sa générosité de regard, sa capacité à nommer les blessures sans les clouer dans le désespoir font de lui un écrivain plus que jamais nécessaire.
Il revient désormais aux institutions culturelles djiboutiennes, aux chercheurs, aux éditeurs et aux enseignants de faire vivre cet héritage, non comme une relique du passé, mais comme une boussole pour l’avenir. Relire Abdi Ismaël Abdi, c’est accepter de se confronter à la réalité, dans ses zones d’ombre comme dans ses promesses. C’est reconnaître qu’en chaque marginal, chaque femme oubliée, chaque enfant brisé, se cache une vérité humaine que seule la littérature peut approcher. C’est, en somme, refuser le silence.
Repose en paix, Abdi Ismaël Abdi. Et que ta parole continue de vibrer au creux des consciences éveillées.
Mohamed Aden














































