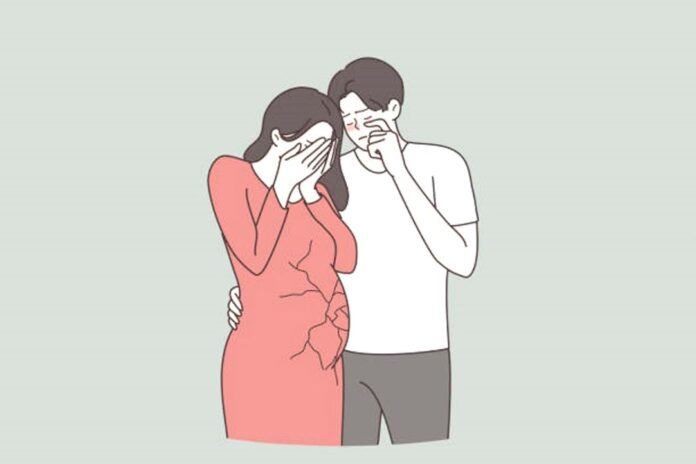
Attendre un bébé est souvent synonyme de joie, d’espérance, et de bonheur. Pourtant, chaque femme le vit différemment. Mais au bout du compte, quand bébé pointe son nez, toutes les douleurs, les insomnies, les maladies de la grossesse disparaissent d’un coup, comme par magie. Mais le cas échéant, si le bébé attendu n’est pas là, comment se sentent les femmes ? Entre douleur et incompréhension de la famille, la perte d’un enfant reste souvent méconnue dans notre société.
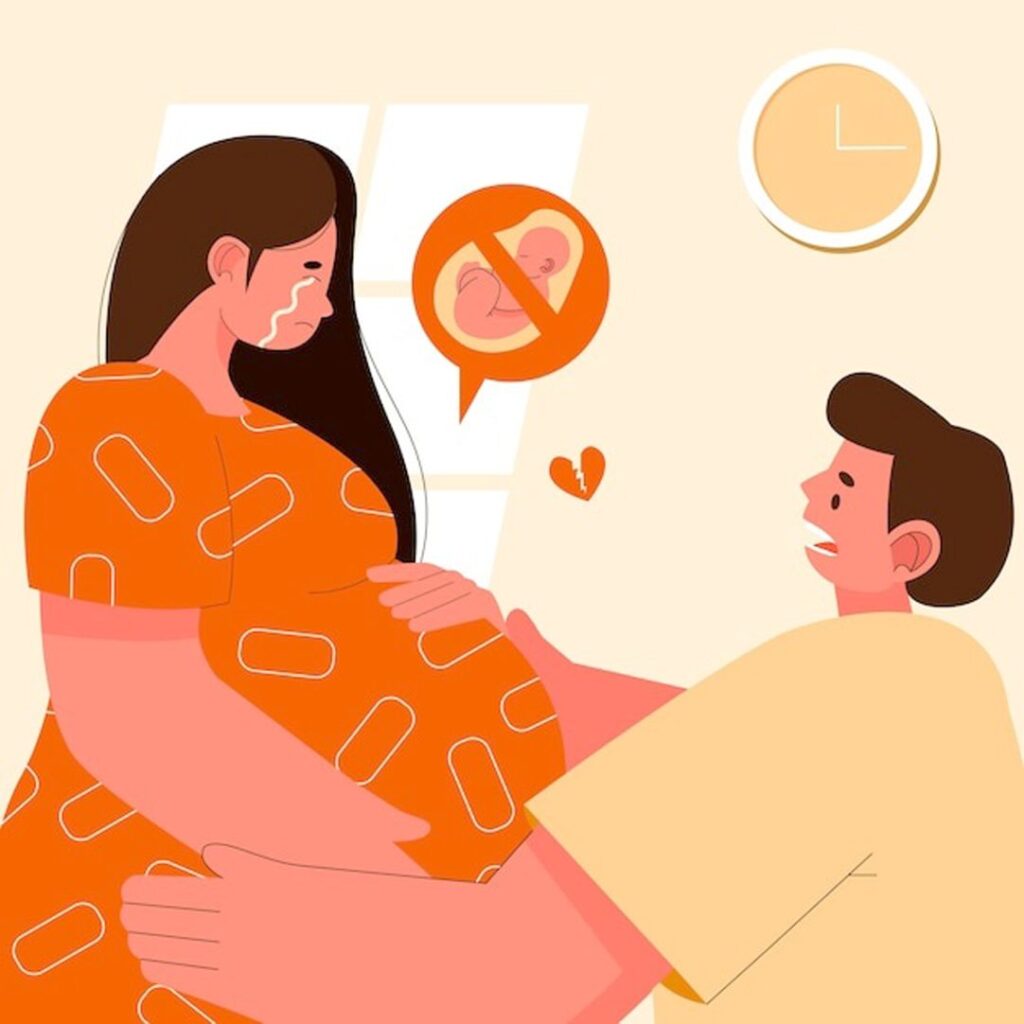
A Djibouti, on aime les enfants, il suffit juste de faire un tour, un après-midi dans les différentes aires de jeux. Des ribambelles de gamins qui courent dans tous les sens, et ce au grand plaisir de leurs parents. Avoir un enfant est une bénédiction divine, et à chaque grossesse, l’on se projette avec plein d’espoir. À qui ressemblera-t-il, est-ce une fille ou un garçon, sera-t-il en bonne santé ? Autant de questions qui tracassent les parents, en plus des rendez-vous interminables avec les médecins. Généralement, les parents des familles, quand arrive enfin l’heure de l’accouchement, trépignent d’impatience dans les couloirs des hôpitaux pour tenir dans leurs mains le nouveau bébé, le nouveau venu qui viendra agrandir les deux familles. Mais parfois, l’attente peut être longue, très longue. Et le pire des scénarios arrive. Bébé n’est plus là, que faire ? Et dans notre pays, le comportement des parents qui viennent de perdre un enfant est souvent très différent. Entre résilience et silence, les femmes à Djibouti sont bien souvent obligées de taire leurs peines. Est-ce normal, ou bien sommes-nous éduqués dans une culture qui impose le silence à chaque défaite ? Perdre un enfant, une douleur bien souvent silencieuse.
Des adieux silencieux…
Dans les hôpitaux partout en Afrique, l’on croise plus de femmes que d’hommes. Les femmes sont perpétuellement aux premières lignes en cas de maladie, ou de grossesse. Elles rendent visite, et discutent avec les malades pour les soulager un peu de leur sort. C’est pourquoi les salles d’accouchement sont souvent bondées de femmes, et on ne sait plus qui vient voir qui. Cousines, tantines, voisines, copines, elles sont toutes à côté des portes, scrutant les allées -retours des sages-femmes. Elles viennent avec la valise de bébé déjà prête et les linges de la maman. Biberons et couche-culottes en main, elles sont toutes fébriles et tendent les oreilles pour écouter les premiers pleurs de bébé. Mais parfois, le pire des scénarios est là. Pas de bébé, pour des raisons qu’on n’ose parfois pas demander, le bébé est mort-né. Dépassement de terme, césarienne tardive, maman en souffrance, autant de raisons qui font tomber à l’eau l’espoir de tenir entre ses mains un enfant.

Une fois conscientes de la perte de leur enfant, les mamans sont confrontées à l’inconnu, elles réalisent qu’elles vont ressortir seules de l’hôpital. Elles ne pleurent pas, elles ne crient pas, elles ne demandent pas pourquoi elles doivent repartir seules, elles affichent un léger sourire qui veut tout dire. La tristesse n’a pas sa place dans notre pays. Nos mères nous ont éduqués à mordre les lèvres à la moindre douleur. Mais pourquoi ? Pourquoi ne peut-on pleurer un enfant qu’on a longtemps attendu, longtemps espéré ? Pourquoi ce regard plein de jugement sur les femmes qui viennent de perdre un enfant. Une chose reste sûre, il ne s’agit pas de s’attarder à verser des larmes sur quelque chose que l’on ne maitrise pas. Les mères sont là, à dire que c’est le destin, certes, mais pourquoi verser, ne serait-ce qu’une seule larme, est tabou ? Généralement, les hommes djiboutiens ne comprennent pas cet état d’esprit. Et leurs comportements divergent. Il y a ceux, qui, pieux, prient et se tournent vers Dieu pour Lui demander de leur accorder d’autres enfants et puis il y a ceux que rien n’atteint, même pas la perte d’un enfant tant désiré. Ils sont dans leur bulle, à ignorer les appels au secours de leurs femmes. Et, elles, bien souvent résignées, se taisent et continuent à vivre dans un quotidien fait de silence et de douleurs.
Relève-toi ma fille, tu en auras d’autres …
Une fois que la maman réalise qu’elle a perdu son enfant, les parents des conjoints sont aux premières loges pour penser à la conception d’un autre bébé. « Arrête d’être triste, tu en auras pleins d’autres. Tu es encore jeune, la vie continue, et l’éternelle réponse « Sheydanka iska naar » (ou repousse le diable) comme si pour pleurer l’on avait besoin du diable. Bref, la douleur de la perte d’un enfant reste très souvent méconnue dans notre pays. Les femmes qui sont confrontées à cette situation n’ont pas le droit de montrer leur tristesse. Elles sont soumises au poids de la tradition qui veut qu’une femme ne montre jamais sa douleur. Pourtant, pleurer un être tant souhaité, tant espéré reste tout à fait normal. Aucune loi ne l’interdit. Aucun être au monde ne peut comprendre la peine que l’on ressent au plus profond de soi quand le bébé qu’on a tant désiré n’est plus là. 9 mois se sont écoulés, où l’on a senti son cœur battre en communion avec le sien, 9 mois où on a cherché un prénom, où on a fait des achats, où on a préparé sa chambre. Autant d’instants d’un bonheur espéré, laissant place à un vide sidéral. Et à la fin, les mères, vous regardent avec des yeux vides d’émotion pour vous demander d’avaler vos peines.
Pour le reste de la famille et des amis, une question se pose. Doit-on lui rendre visite, ou doit-on la laisser se reposer ? Une question qui n’aura pas eu sa place si bébé était là. La maison aurait été bondée de monde, entre les voisins qui viennent voir si le bébé ressemble à son père, les amies qui s’échappent du travail pour papoter, ou le papa qui fait des allers-retours entre la maison et la pharmacie. Tout ce beau monde déserte les lieux. Tel un champ de bataille, personne n’ose approcher la maman qui couve seule sa souffrance. Beaucoup de femmes djiboutiennes traversent seules cette période de deuil périnatal. Confrontées au regard des autres, elles se taisent très souvent, par peur d’être incomprises ou mal jugées. Pourquoi, juger une femme qui fait face à une perte est mal perçu, pourquoi ne pas lui donner la force de surmonter ce cap difficile ? Il serait peut-être temps de changer de mentalités et d’aider ces femmes, car, ici à Djibouti, la perte d’un enfant est malheureusement douloureuse et silencieuse.
N. Kadassiya














































