
Au tournant du siècle, la République de Djibouti s’est trouvée face à un défi historique : refonder son système éducatif, hérité du passé colonial, inadapté aux réalités nationales et incapable de répondre aux aspirations d’une jeunesse en pleine expansion. De ce constat est née, en 1999, la grande réforme de l’école djiboutienne, portée par une volonté politique affirmée du Président Ismaïl Omar Guelleh et traduite dans les faits par une refondation en profondeur du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFOP).
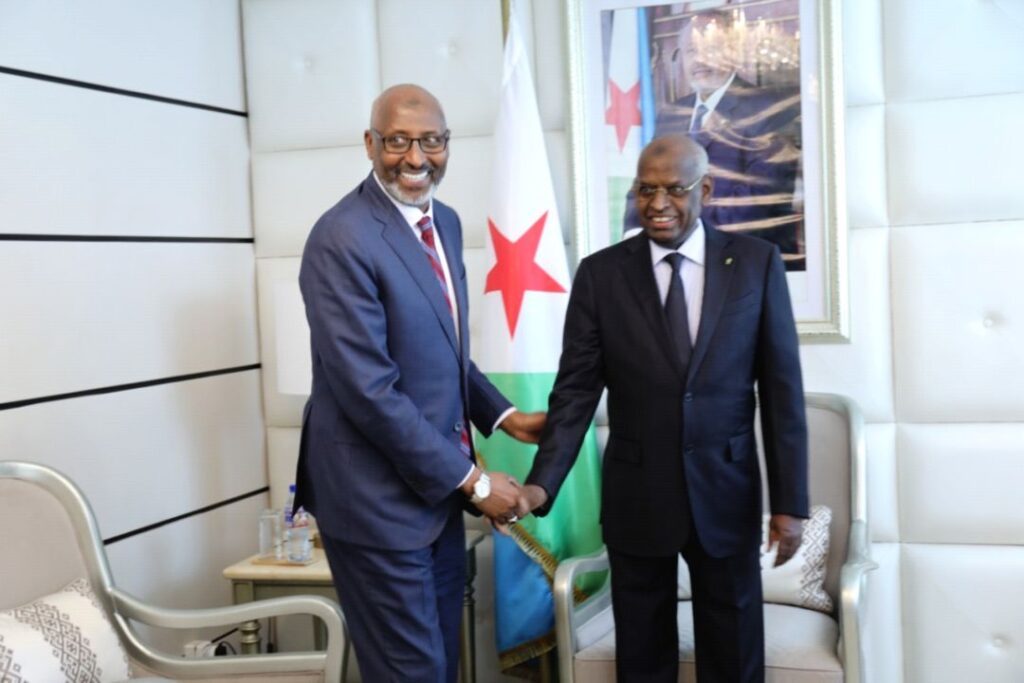
Une école à reconstruire. À la fin des années 1990, les indicateurs éducatifs du pays étaient alarmants. Le taux brut de scolarisation stagnait autour de 40 %, avec de fortes disparités entre les zones urbaines et rurales. Les infrastructures scolaires, souvent concentrées dans la capitale, ne permettaient pas d’accueillir la vague démographique de jeunes enfants en âge d’être scolarisés. Quant aux contenus d’enseignement, ils demeuraient largement calqués sur les programmes français, sans réelle adaptation au contexte local. Cette situation reflétait une crise systémique : l’école djiboutienne formait peu, formait mal, et reproduisait les inégalités sociales. Conscient que le développement national passait avant tout par l’éducation, le nouveau Chef de l’État, Ismaïl Omar Guelleh, a placé ce chantier au cœur de son premier mandat. En 1999, il confie au ministère de l’Éducation la mission de concevoir une réforme globale, tournée vers l’universalisation de l’enseignement de base et la qualité de l’apprentissage.
Le diagnostic fondateur. La première étape fut celle du diagnostic. Le ministère a lancé un vaste travail d’évaluation, associant les experts nationaux, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les représentants des enseignants.

Ce diagnostic a mis en lumière quatre priorités : la généralisation de l’accès, la modernisation des programmes, la formation des enseignants, et la réorganisation administrative du système éducatif. Cette réflexion collective a débouché sur l’élaboration d’un document stratégique majeur : la Lettre de politique éducative nationale, qui a servi de feuille de route à la réforme. Le texte posait les principes fondateurs d’une école djiboutienne inclusive, équitable et de qualité, ancrée dans les valeurs nationales et ouverte sur le monde.
Une volonté politique ferme et une vision claire. Dès le début, la réforme de l’école djiboutienne s’est distinguée par la clarté de sa vision. Il ne s’agissait pas d’une simple adaptation technique, mais d’une refondation philosophique : replacer l’école au cœur du projet de société. Le Président Ismaïl Omar Guelleh, dans plusieurs discours, a souligné que « l’éducation constitue la clé de notre indépendance intellectuelle et le moteur de notre développement ».
Le gouvernement a ainsi adopté une approche globale, combinant l’expansion quantitative des infrastructures à une profonde réforme qualitative du système. Les efforts ont d’abord porté sur la construction et la réhabilitation d’écoles à travers le pays, notamment dans les régions de l’intérieur, longtemps délaissées. Parallèlement, de nouveaux programmes scolaires ont été conçus pour mieux intégrer les réalités linguistiques et culturelles nationales.
La refonte du ministère et la montée en puissance des acteurs locaux. Un des aspects les plus marquants de la réforme fut la restructuration du ministère lui-même. Le MENFOP, tel qu’on le connaît aujourd’hui, est né de cette réorganisation. Il s’est doté de directions techniques spécialisées, d’un service d’inspection rénové, et de nouvelles institutions chargées de la planification, de l’évaluation et de la formation des enseignants.
Cette refonte administrative visait à rapprocher l’école des réalités du terrain. Les Directions régionales de l’éducation (DREN) ont vu le jour, permettant une gestion plus décentralisée et participative du système. L’école n’était plus seulement une affaire d’État : elle devenait un projet collectif, impliquant les collectivités locales, les parents et les communautés.
L’accent sur la formation et la qualité de l’enseignement. La réforme a aussi misé sur l’humain. Le développement professionnel des enseignants est apparu comme une condition indispensable à la réussite du changement. La création du Centre de Formation des Enseignants de l’Enseignement Fondamental (CFEEF) a permis de structurer un dispositif de formation initiale et continue, fondé sur les besoins réels du terrain.
De nouveaux curricula ont été élaborés pour les écoles normales, intégrant la pédagogie active, la gestion de classe, l’évaluation formative et l’utilisation des technologies éducatives. La réforme a également favorisé l’émergence d’une nouvelle génération d’enseignants djiboutiens, mieux formés, plus motivés et fiers d’appartenir à une mission nationale.
L’élargissement de l’accès : une école pour tous. L’un des succès les plus visibles de la réforme réside dans l’élargissement de l’accès à l’éducation. En vingt ans, le nombre d’écoles primaires a plus que doublé, permettant de scolariser des dizaines de milliers d’enfants supplémentaires. Le taux brut de scolarisation au primaire dépasse désormais les 90 %, une progression remarquable pour un pays de taille modeste mais aux contraintes géographiques et climatiques fortes. Les efforts ont particulièrement bénéficié aux filles, aux enfants des zones rurales et aux populations nomades. Des écoles communautaires ont été implantées dans les localités éloignées, tandis que des campagnes de sensibilisation ont encouragé les familles à inscrire leurs enfants.
Cette démocratisation de l’accès à l’éducation traduit la concrétisation du principe d’équité : aucun enfant, quelle que soit son origine ou sa condition sociale, ne doit être privé de son droit à apprendre.
La modernisation des contenus et la valorisation des langues nationales. La réforme n’a pas seulement élargi l’accès à l’école : elle en a aussi profondément renouvelé le contenu. Les programmes ont été revus pour mettre l’accent sur les compétences de base — lire, écrire, compter, raisonner — tout en intégrant des disciplines nouvelles, comme les sciences, la technologie ou l’éducation civique.
Un effort particulier a été consenti pour valoriser les langues nationales, en complément du français et de l’arabe. Ce choix symbolique marque la volonté de bâtir une école enracinée dans la culture djiboutienne, ouverte à la diversité linguistique et respectueuse de l’identité du pays.
Les effets de la réforme : progrès et défis. Deux décennies après son lancement, la réforme éducative djiboutienne porte ses fruits. Les progrès sont visibles dans tous les segments : accès, parité, formation, équipements, gouvernance. L’école est devenue un instrument essentiel de cohésion sociale et de mobilité. Les jeunes générations, mieux éduquées, accèdent désormais à des parcours d’études supérieures et à des emplois qualifiés.
Cependant, les défis demeurent. Le système doit consolider les acquis et répondre à de nouvelles exigences : la qualité de l’enseignement, la pertinence des apprentissages, la maîtrise du numérique et l’adéquation entre formation et emploi. Le gouvernement en est pleinement conscient et a engagé, depuis 2020, une deuxième phase de modernisation, en lien avec la Vision Djibouti 2035.
Vers une école de l’excellence et de l’innovation. Dans cette nouvelle étape, l’accent est mis sur la performance et l’innovation. Le MENFOP s’est doté d’outils modernes de suivi et d’évaluation, et collabore étroitement avec les partenaires internationaux pour intégrer les meilleures pratiques pédagogiques.
L’introduction progressive du numérique à l’école, la formation aux métiers du futur et la promotion de l’enseignement technique et professionnel témoignent de cette orientation.
Le ministère encourage également la recherche éducative et la production de ressources pédagogiques locales. L’objectif est clair : bâtir une école djiboutienne de l’excellence, capable de former des citoyens responsables, compétents et attachés aux valeurs de la République.
Un modèle de réforme maîtrisée. Vingt ans après sa mise en œuvre, la réforme de l’école djiboutienne apparaît comme un modèle de continuité et de cohérence politique. Là où beaucoup de pays connaissent des changements de cap fréquents, Djibouti a su maintenir une ligne directrice stable, en adaptant progressivement ses priorités aux réalités du terrain.
Ce succès tient à trois facteurs : une volonté politique forte, une planification rigoureuse, et une appropriation collective du changement. Le leadership du Président Ismaïl Omar Guelleh, l’engagement des enseignants et la mobilisation des partenaires ont permis d’ancrer durablement la réforme dans le paysage national.
Une refondation au service du développement. L’école djiboutienne n’est plus celle des années 1990. Elle s’est transformée, structurée, ouverte. Elle accompagne désormais la transformation du pays tout entier, en préparant les générations qui bâtiront l’avenir. En investissant massivement dans l’éducation, Djibouti a fait le choix le plus sûr pour son développement : celui du capital humain. Cette conviction, au cœur de la réforme, reste plus que jamais d’actualité. Car c’est dans les salles de classe, auprès des élèves et de leurs enseignants, que se joue la promesse d’une nation prospère, juste et fière de son identité.













































