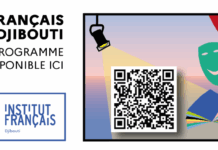Les civilisations ne s’éteignent pas toujours sous les coups de l’ennemi extérieur ; parfois, elles s’effritent par un consentement intérieur, une abdication progressive de leurs forces vives. Le khat, à Djibouti, incarne cette abdication. Plus qu’une simple habitude, il est devenu une forme d’aliénation collective, un anesthésiant social qui confisque la liberté individuelle et menace le destin national.
Car la liberté véritable ne consiste pas à céder à toutes les sollicitations du présent. Elle est au contraire ce pouvoir de se projeter dans le temps, d’ordonner ses désirs à un avenir, de préférer la construction lente au plaisir immédiat. Or le khat inverse cet ordre : il enferme la jeunesse dans un cycle de satisfaction éphémère où l’après-midi se réduit à mâcher, où la nuit s’use dans l’insomnie, et où le matin s’éteint dans une léthargie sans dessein. C’est une servitude d’autant plus redoutable qu’elle se vit comme un choix.
Il faut nommer ce mécanisme pour ce qu’il est : une aliénation consentie. L’individu croit se détendre, se retrouver, participer à une tradition. Mais en réalité, il s’enchaîne à un besoin qui dicte ses gestes, ses horaires, ses relations sociales. Plus encore, ce besoin prépare insidieusement le terrain à des dépendances plus violentes. Le khat, excitant fragile, devient souvent l’antichambre des drogues dures, comme si la feuille verte n’était qu’un prélude à des abîmes plus sombres. Tant de jeunes, frustrés de ses limites, glissent vers d’autres substances : cannabis, cocaïne, amphétamines.
Cette aliénation n’est pas seulement personnelle, elle est collective. Une nation vit de l’énergie de sa jeunesse, de sa capacité à apprendre, à inventer, à bâtir. Mais lorsque cette énergie se dilue dans l’obsession d’un végétal stérile, c’est l’avenir commun qui se trouve amputé. Dans les établissements scolaires, les bancs se vident dès l’après-midi, preuve que la mastication supplante l’apprentissage. Dans les entreprises et administrations, la productivité décline, car un corps engourdi et un esprit absent ne bâtissent pas l’avenir. Dans de nombreux foyers, une part considérable du revenu – parfois jusqu’à un tiers – est engloutie dans l’achat du khat, au détriment de la nourriture, de l’éducation et des soins. L’horizon du pays s’assombrit. Chaque branche de khat consommée est un fragment d’avenir sacrifié, un pan de destin national compromis. Les sociologues l’ont montré : une jeunesse engluée dans l’oisiveté et l’addiction est une jeunesse privée de citoyenneté active, une force vive transformée en poids mort.
Et pourtant, le khat reste enveloppé d’une tolérance sociale. On l’invoque au nom de la tradition, de la convivialité, de l’économie. Mais qu’est-ce qu’une tradition qui mutile ses enfants ? Qu’est-ce qu’une convivialité qui détruit le lendemain de ceux qui la partagent ? Qu’est-ce qu’une économie bâtie sur la léthargie et la dépendance ? Une tradition véritable éclaire et élève ; le khat, lui, obscurcit et rabaisse. Il est moins une coutume qu’une illusion collective, un voile qui cache une lente hémorragie nationale.
L’histoire des autres nations doit nous éclairer. D’après le rapport de SUN-Yemen, publié en 2022, le Yémen a vu sa sécurité alimentaire menacée par la monoculture du khat. Selon une étude publiée en 2017 sur l’impact psychologique, économique et social de la consommation du khat chez les adolescents et les adultes dans la ville de Nekemte, l’Ethiopie a constaté la chute de sa productivité et de sa vitalité sociale. Partout, le même constat : ce qui est toléré comme coutume finit par se révéler comme une entrave majeure au développement. Djibouti est averti : l’histoire n’épargne pas ceux qui refusent de lire ses leçons.
Djibouti n’est pas resté totalement inerte. Des campagnes de sensibilisation existent, des projets de formation professionnelle émergent, des activités sportives sont proposées aux jeunes pour détourner leur énergie. Mais ces initiatives restent timides, inégales, souvent étouffées par la force de l’habitude. Elles ressemblent à des étincelles dans une nuit trop dense. Ce qu’il faut, c’est un sursaut collectif, une orientation stratégique, une stratégie éducative et sociale de grande ampleur. Il faut apprendre aux enfants, dès les premières années, à reconnaître le piège du khat ; offrir aux jeunes des alternatives – travail, culture, loisirs – qui remplacent la torpeur par l’espérance.
Il s’agit de restituer à la jeunesse le sens de la liberté, qui n’est pas jouissance immédiate mais puissance de construction. Il s’agit de briser le cercle vicieux qui mène du khat aux drogues dures. Il s’agit enfin de briser l’illusion collective qui entoure cette plante : le khat n’est pas un héritage à préserver, mais un monstre qui dévore les forces de demain.
La lutte contre le khat n’est pas seulement combattre une plante : c’est reconquérir le temps volé, rétablir la dignité perdue, libérer la jeunesse de ses chaînes invisibles. C’est choisir de ne pas abandonner l’avenir à une habitude mortifère.
Car une nation se mesure certes à la grandeur de ses ports et à la solidité de ses alliances, mais aussi et surtout à la vigueur intérieure de ses citoyens. Et lorsque cette vigueur s’égare dans la mastication sans fin d’une herbe amère, c’est la respiration même du pays qui se fige. Le khat n’est pas seulement une plante ; il est le miroir où se joue, aujourd’hui, la question essentielle de la liberté et du destin.
La véritable question posée par le khat n’est pas seulement sanitaire ou économique, elle est existentielle : voulons-nous être les gardiens de notre avenir ou les spectateurs de son effritement ? Accepter sa prolifération, c’est choisir la torpeur, la dépendance, la lente agonie. Le combattre, c’est affirmer que la liberté est encore possible, que l’avenir peut encore être sauvé.