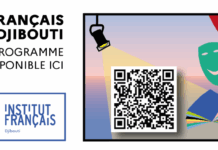La corruption, notion à la fois familière et fuyante, peut être définie comme l’abus d’un pouvoir confié – qu’il soit privé ou public – à des fins d’enrichissement personnel ou de privilège indu. Elle constitue un mode clandestin d’appropriation des biens communs, un détournement silencieux des finalités de l’Etat, et, plus largement, une trahison du pacte civique qui fonde la vie collective. Si elle prospère dans l’ombre, ses effets se déploient pourtant au grand jour : ils altèrent la structure économique, minent le tissu social et compromettent les possibilités mêmes du développement. Dans les pays en voie de développement, la lutte contre la corruption occupe une place cruciale, presque vitale. Toutefois, dans de nombreux contextes, elle se limite à la création d’institutions chargées d’y faire face, institutions dont la mission se réduit trop souvent à la prévention : produire des messages de sensibilisation, organiser des ateliers, compiler des rapports. Ces structures, privées d’outils d’enquête autonomes comme de pouvoirs de sanction contraignants, demeurent cantonnées au rôle d’observatrices impuissantes. Elles alertent, mais ne peuvent agir. Ainsi les pratiques illicites se perpétuent, prospèrent, se normalisent, sans conséquences véritables pour leurs auteurs.
Sur le plan économique, la corruption introduit une distorsion profonde dans l’allocation des ressources : elle privilégie l’accès aux rentes plutôt que l’investissement productif, détourne les fonds publics de leur vocation, et installe un climat d’incertitude qui décourage les investisseurs. Les projets de long terme deviennent hasardeux, les coûts imprévisibles, les partenariats fragiles. La croissance se trouve ainsi enchaînée à des logiques de court terme, à des arrangements obscurs, à l’arbitraire des intérêts particuliers. Sur le plan social, la corruption opère une érosion lente mais redoutable. Elle sape la confiance des citoyens envers l’Etat, nourrit un sentiment d’injustice, fragilise le contrat social qui devrait unir gouvernants et gouvernés. Lorsque la norme devient l’exception, lorsque la règle s’efface derrière le privilège, la société se fissure et le civisme s’étiole.
Face à ce défi, comment envisager une lutte réellement efficace ? Une voie essentielle réside dans une réforme structurelle de la gouvernance publique, fondée sur la numérisation intégrale de la gestion financière de l’Etat. La mise en place de systèmes capables de tracer chaque transaction – de la collecte des impôts à l’exécution des dépenses – permet de réduire drastiquement les zones d’opacité où s’enracinent les abus. Plusieurs pays en voie de développement ont démontré l’efficacité de ces dispositifs : la digitalisation de l’administration fiscale limite le favoritisme, réduit les contacts directs entre agents et contribuables – autant de situations propices aux pots-de-vin – et accroît, ce faisant, les recettes publiques. De même, l’enregistrement en temps réel des dépenses favorise la prévisibilité budgétaire, renforce la discipline financière et inspire confiance aux partenaires internationaux.
La numérisation, lorsqu’elle est conduite avec rigueur et soutenue par une volonté politique authentique, constitue ainsi un levier puissant d’assainissement de la gestion publique. Elle ouvre la voie à une transparence accrue, à une administration plus efficace, et à une restauration progressive de la confiance citoyenne. Elle n’est toutefois pas une panacée. La technologie ne remplace ni l’indépendance des organes de contrôle, ni un cadre juridique robuste, ni des mécanismes de sanction crédibles. Sans ces garde-fous, les plateformes numériques risquent de n’être que des vitrines, affichant une modernité de façade sans transformer les pratiques profondes. Les réformes durables sont celles qui articulent harmonieusement innovation technologique, volonté politique ferme et culture de reddition des comptes. C’est à cette convergence que se mesure la solidité des institutions et la maturité des Etats.
Djibouti, aujourd’hui, se tient à un moment charnière de son destin. Sa position géostratégique exceptionnelle – interface des flux maritimes mondiaux, hub logistique au carrefour des continents – lui confère des potentialités extraordinaires. Mais ces potentialités ne se mueront en croissance durable que si le cadre institutionnel est purifié de ses zones d’opacité. Le président de la République l’a souligné : la corruption, si elle n’est pas contenue, peut devenir « une épidémie mortelle ». Cette formule n’est pas un effet rhétorique : elle énonce un diagnostic. La corruption, si elle n’est pas combattue, transforme l’Etat en organisme vulnérable, où chaque dysfonctionnement nourrit un autre. Ainsi, l’avenir djiboutien dépend de la capacité du pays à instaurer une traçabilité intégrale de la gestion publique, à associer chaque dépense à un responsable, chaque décision à une autorité identifiable, chaque acte de gestion à une obligation d’en rendre compte. C’est dans cette exigence que se trouve la condition d’émergence d’un Etat moderne, juste et efficace. Et c’est dans cette volonté de transparence radicale, que se joue la possibilité pour Djibouti de convertir son potentiel géostratégique en un destin pleinement assumé.