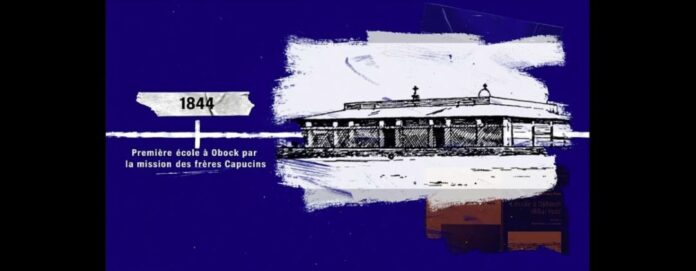
Chaque année, la Journée mondiale de l’enseignant est l’occasion de rendre hommage à celles et ceux qui, par leur engagement, transmettent le savoir et ouvrent des horizons nouveaux aux générations futures. Derrière chaque classe, chaque cahier et chaque mot appris, il y a toujours des pionniers qui ont osé poser les premières pierres de l’éducation. À Djibouti, cette histoire commence bien avant la construction des grandes écoles de la capitale. En effet, elle prend racine dans un petit port balayé par les vents, Obock, où, à la fin du XIXᵉ siècle, les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny ouvrirent la toute première école du pays. Leur mission, fragile mais déterminante, allait marquer un tournant et inscrire Obock dans la mémoire éducative nationale.
À cette époque, Obock n’était encore qu’un port isolé, battu par les vents, où s’arrêtaient les navires marchands et militaires en route vers l’océan Indien. Or, les autorités françaises y installèrent un comptoir, première étape de ce qui deviendra la Côte française des Somalis. Dès lors, le besoin d’infrastructures sociales se fit sentir : soins de santé, structures d’accueil et surtout éducation. C’est précisément dans ce contexte que les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny furent appelées. La congrégation, fondée en 1807 par la bienheureuse Anne-Marie Javouhey, s’était déjà spécialisée dans les missions lointaines. Présentes en Afrique, aux Antilles et en Asie, elles combinaient action éducative, soins médicaux et accompagnement social. Ainsi, en arrivant à Obock, elles trouvèrent un terrain vierge mais semé d’obstacles.

L’histoire orale et quelques archives missionnaires rapportent que les premières religieuses débarquèrent par bateau depuis Aden. Certaines venaient du nord de la France et, dans la mémoire locale, on les appelle parfois « les Sœurs de Calais ». Officiellement toutefois, elles appartenaient bien à la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Dès leur installation dans des bâtiments modestes, faits de pierre et de bois, elles entreprirent d’ouvrir une petite école. L’initiative était audacieuse : dans une région où l’éducation formelle n’existait pas, où les traditions orales dominaient et où le français était totalement étranger, il fallait convaincre les familles, gagner la confiance et surmonter de nombreux obstacles.
Peu à peu, la première école d’Obock accueillit un petit groupe d’enfants, essentiellement des garçons. On y enseignait les rudiments : lecture, écriture, calcul, mais aussi des notions d’hygiène et des leçons élémentaires de sciences naturelles. L’enseignement, bien que simple, était adapté aux réalités locales et ouvrait déjà de nouvelles perspectives. Or, la mission des Sœurs ne se limitait pas à la transmission du savoir. En réalité, elles constituaient un véritable centre de vie sociale. Elles dispensaient des soins de santé, soutenaient les familles pauvres et accueillaient des orphelins. De fait, leur rôle dépassait largement les salles de classe : elles représentaient un pont entre les autorités coloniales et la population locale, souvent méfiante à l’égard des Européens. Certes, pour de nombreuses familles, envoyer un enfant à l’école représentait un pari risqué. Néanmoins, la curiosité et la soif d’apprendre l’emportèrent rapidement. L’idée que l’écriture et le calcul pouvaient ouvrir des perspectives nouvelles séduisit certains notables. Dès lors, l’école gagna en fréquentation et devint un lieu de rencontre sociale, où se côtoyaient enfants de commerçants et fils de pêcheurs.
Cependant, l’aventure n’était pas sans épreuves. Les conditions de vie à Obock étaient particulièrement rudes : chaleur étouffante, manque d’eau douce, isolement et maladies tropicales. Plusieurs religieuses tombèrent malades, certaines durent repartir vers la France et d’autres moururent sur place, laissant une trace émouvante dans les registres missionnaires. À cela s’ajoutait un autre défi : l’administration coloniale voulait développer un enseignement de type français afin de former une main-d’œuvre docile, tandis que la population locale cherchait à préserver ses traditions. Ainsi, les Sœurs durent constamment naviguer entre adaptation et fidélité à leur mission.
Or, la fondation de la ville de Djibouti en 1888 changea profondément la donne. Peu à peu, Obock perdit de son importance stratégique au profit de la nouvelle capitale. L’administration coloniale transféra ses services et les Sœurs suivirent le mouvement. Pourtant, l’expérience d’Obock ne fut pas vaine. Bien au contraire, elle servit de premier laboratoire éducatif. Les religieuses avaient prouvé qu’une école pouvait exister, attirer des enfants et jouer un rôle social majeur. Ce modèle fut ensuite reproduit à Djibouti-ville, où les Sœurs ouvrirent d’autres établissements, mieux structurés et plus durables.
Aujourd’hui encore, plus d’un siècle plus tard, le souvenir de ces pionnières demeure dans la mémoire collective. Les anciens relatent avec étonnement la présence de ces femmes européennes, voilées de blanc, qui enseignaient aux enfants locaux. Certains élèves, mentionnés dans les archives, devinrent par la suite interprètes, commerçants ou cadres administratifs. Ainsi, la petite école des Sœurs fut le point de départ d’une transformation plus vaste : l’introduction de l’école moderne dans la région. Si l’éducation coranique continua parallèlement, l’expérience d’Obock démontra que l’école occidentale pouvait s’implanter, même dans un environnement hostile.
En définitive, pourquoi se souvenir de cette page d’histoire ? D’abord, parce qu’elle rappelle que l’éducation à Djibouti est née d’initiatives courageuses, menées dans des conditions difficiles. Ensuite, parce qu’elle souligne que derrière chaque institution se trouvent des personnes concrètes : en l’occurrence, des femmes missionnaires, qui ont osé bâtir une école là où rien n’existait. Certes, leur rôle n’était pas neutre et s’inscrivait dans un cadre colonial, mais il illustrait une dynamique essentielle : le passage d’une société à dominante orale vers l’écrit, et la naissance de l’école comme espace collectif.
Aujourd’hui encore, alors que Djibouti investit massivement dans son système éducatif et se projette vers l’avenir, cette mémoire éclaire le chemin parcouru. De la modeste salle de classe d’Obock aux universités modernes, l’histoire dessine une continuité remarquable. Finalement, la première école d’Obock, fondée par les Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, ne fut peut-être qu’une structure fragile et éphémère, mais son importance symbolique est immense. Elle incarne la naissance de l’école moderne à Djibouti et rappelle que toute grande histoire commence toujours par un premier pas – en l’occurrence, celui de quelques femmes venues de loin, convaincues que l’éducation pouvait transformer des vies.
Ali Salfa










































