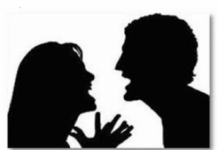Au 7ᵉ Sommet entre l’Union africaine et l’Union européenne, tenu à Luanda en Angola, le discours du Président Ismaïl Omar Guelleh n’a rien eu d’un propos de convenance. Il a été au contraire un rappel sans détour des réalités géopolitiques et des responsabilités partagées dans un monde en recomposition rapide.
Sous les formules protocolaires et le langage diplomatique, une ligne de fond se profile : l’Afrique ne veut plus être un simple théâtre d’intérêts et exige d’être un acteur à part entière du jeu international. En réaffirmant l’attachement à la « Vision commune 2030 UA-UE », le chef de l’État djiboutien a surtout rappelé les conditions d’un partenariat débarrassé des ambiguïtés anciennes.
Mais c’est sur la question de la sécurité de la mer Rouge que le discours présidentiel prend toute sa dimension stratégique. Il fait le lien direct entre les attaques contre la navigation, la piraterie dans le Golfe d’Aden et les déséquilibres économiques mondiaux. En insistant sur la position centrale de Djibouti au détroit de Bab el-Mandeb, il souligne une évidence trop souvent négligée, qui veut que la sécurité européenne commence aussi sur les rivages africains.
Le message est limpide : Djibouti assume pleinement ses responsabilités d’État riverain, mais refuse d’être seul face à un enjeu qui dépasse de loin ses capacités nationales. L’hommage rendu à l’opération européenne EUNAVFOR ASPIDES est ainsi mesuré. Oui, cette opération est utile. Non, elle n’est pas suffisante. La stabilisation durable de la zone exige une architecture régionale intégrée, incluant les États riverains, les organisations africaines et les partenaires européens.
Au-delà de la mer, le président djiboutien a replacé Djibouti dans son rôle régional de pivot diplomatique, en tant que pays hôte du siège de l’IGAD. Guerre au Soudan, fragilité du Soudan du Sud, pression migratoire massive, insécurité maritime… La Corne de l’Afrique est décrite comme un foyer de tensions systémiques, dont les ondes de choc dépassent largement les frontières régionales. Là encore, la demande est claire : le soutien européen doit être renforcé, structuré et cohérent avec les engagements déjà pris.
En vérité, ce discours tranche par sa lucidité. Pas de surenchère, pas de posture idéologique, mais un appel constant à la responsabilité collective. Là où certains se contentent de slogans sur la coopération, Djibouti parle d’investissement stratégique, de transformation économique, de fidélité aux engagements. En creux, le Président met en garde contre l’un des maux récurrents du partenariat international : l’addition d’initiatives disparates et sans vision de long terme.
À l’heure de la fragmentation géopolitique, du recul du droit international et de la brutalisation des rapports de force, l’axe Afrique–Europe ne peut survivre que s’il devient un véritable espace de co-décision, et non un simple cadre de financement ou de gestion de crises.
Le discours de Luanda aura ainsi eu le mérite de rappeler une vérité simple et souvent occultée : on ne sécurise pas les routes du commerce mondial sans sécuriser les rives africaines. On ne stabilise pas l’Europe sans investir dans la paix de la Corne de l’Afrique, et l’on ne bâtit aucun partenariat crédible sans respect des souverainetés.